Au fil de mes multiples expériences, j’ai pu constater que la sincérité payait toujours… dans la limite des plafonds de verre divers et variés.
Pour en arriver à ce que je souhaite exprimer, je vais partir d’idées fausses pourtant bien ancrées : les romans pour ados best-sellers classés en littérature jeunesse seraient nécessairement des produits formatés, il y a même le soupçon qu’ils seraient imaginés à la façon de certaines séries télévisées, par un pool de scénaristes, on prendrait les ingrédients à la mode, on touillerait et hop le beau succès que voilà.
Ce soupçon vient en grande partie du fait que les meilleures ventes en France dans ce domaine sont régulièrement, essentiellement anglo-saxonnes, et portées par des adaptations cinématographiques. On ne côtoie pas les auteurs lors des salons du livre, on ne peut pas s’assurer de leurs recettes d’écriture s’il en existe, certains en déduisent un peu vite que, si ça se trouve, derrière JK Rowling, Veronica Roth ou Suzanne Collins il y aurait en réalité pléthore de cerveaux qui se concerteraient avant de pondre leurs produits. Très bizarrement, ce soupçon pèse moins sur d’autres auteurs anglo-saxons à succès, John Green ou Robert Muchamore, mais ce n’est sans doute pas parce que ce sont des hommes, eux, je n’ose soupçonner tous ces soupçonneurs d’être misogynes, oh que non.
Partant de ce soupçon, l’aigreur peut s’amplifier : il serait injuste que ces purs produits commerciaux anglo-saxons empêchent la visibilité de produits artistiques de qualité bien française. Mais l’injustice est-elle bien celle-ci ?
Il est vrai que les traductions anglo-saxonnes qui ont déjà cartonné outre-manche ou outre-atlantique sont beaucoup, mais alors beaucoup mieux mises en avant que les autres romans, quels qu’ils soient. On s’est tous, nous auteurs jeunesse français, étranglé peu ou prou lorsque dans un salon du livre où on prenait la peine de se déplacer on devait signer non loin d’une PLV monumentale remplie de traductions à succès aux couvertures criardes (sans que les auteurs en question soient là, bien sûr). C’est un petit peu énervant, avouez. Et on apprécie quand nos amis libraires nous soutiennent autant qu’on les soutient, nous.

(Une PLV c’est une Publicité sur Lieu de Vente)
Pour autant, il ne faut pas s’en arrêter là, et avant de s’énerver vraiment, il faut LIRE. Et lorsqu’on lit Harry Potter ou Hunger Games (je n’ai pas lu Divergente), ou d’autres succès tels que les romans de John Green, plusieurs évidences me sautent aux yeux, à moi personnellement : le talent, l’originalité, la sincérité. Je ne crois pas qu’en littérature, le manque de sincérité puisse fonctionner. Disons que ça peut, mais seulement un temps. Le lecteur se rend vite compte qu’on l’a pris pour une buse. Parce que figurez-vous que le lecteur, même enfant ou adolescent (scoop), est rarement idiot (puisqu’il lit). Et je suis persuadée que ces auteurs anglo-saxons ont écrit seuls, avec leurs tripes.
Certains auteurs qui ont cru à l’application de recettes se sont dit : ah ben tiens pourquoi pas moi alors ? Ils ont appliqué les recettes et les avez-vous vus dans les meilleures ventes plus d’une semaine ou deux ? Non. CQFD.
Par vagues voire tsunamis, on se rend régulièrement compte d’un truc absolument fou : le talent doublé de la sincérité avec une bonne dose d’originalité, eh bien ça fonctionne même si on est français. Oui. Les plus longs à vouloir le comprendre, il faut bien dire que ce sont les éditeurs. Si on comparait chez certains le budget alloué à la promo des livres anglo-saxons avec celui des livres français, nous n’aurions que l’envie de nous jeter d’un pont. Mais non restez là, les lignes ne sont pas si nettes. En France, on voit depuis longtemps des Français écrire des best-sellers (je parle toujours des romans pour ados ou YA, uniquement), ils s’appellent, ou hélas s’appelaient Pierre Bottero, Marie Desplechin, Gudule, Jean-Claude Mourlevat, Susie Morgenstern, Anne-Laure Bondoux, Marie-Aude Murail, Timothée de Fombelle, et j’en oublie – et ce qui est très bizarre c’est que souvent ne sont cités que les hommes de ce palmarès très mixte, mais je n’oserais accuser le milieu littéraire et culturel français fut-il dans le milieu de la jeunesse (avec une majorité de prescriptrices femmes et une minorité de prescripteurs hommes) d’être un peu macho ou en pâmoison devant ces messieurs, oh que non -. Et d’ailleurs depuis peu, ce sont en majorité des filles qui arrivent en force : Christelle Dabos, Marine Carteron, Clémentine Beauvais, et oui, bon, j’évite de parler de mes propres romans dans des billets de ce type, mais le collectif U4 est d’une parité exemplaire, isn’t it ?
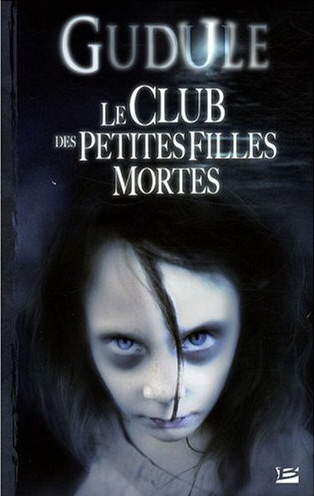
(Hommage à Gudule)
Petite parenthèse à ce propos : non, le collectif U4 ne cache pas non plus un pool d’auteurs appelés par les maisons d’édition pour des brainstormings encadrés aux ingrédients décidés à l’avance. Ca n’aurait pas marché, tout comme Qui es-tu Alaska, par exemple parmi tant d’autres, n’aurait pas fonctionné s’il avait été conçu comme ça. Non, U4, c’est uniquement 4 auteurs qui se sont choisis spontanément, et qui tout du long ont fait preuve de sincérité. Ce n’était pas un produit marketing pendant l’écriture. Certes ensuite il a été promu avec un plan marketing en béton, rarement vu déployé pour des romans jeunesse français. Enfin, pour une fois, les fameuses PLV dédiées à une seule série contenaient des romans français. Si les éditeurs ont choisi de promouvoir U4 aussi bien, pour une fois, que des romans anglo-saxons, c’est qu’ils y ont cru au moment où ils ont lu la première version de nos romans, non pas parce que c’était défini dans le plan de départ. D’ailleurs nous avons écrit durant de longs mois avec un à-valoir aussi faible que d’habitude, en littérature jeunesse…
Et c’est la dernière marche à franchir : la marche financière. Si la preuve est faite que les Français peuvent écrire d’aussi bons romans à succès que les anglo-saxons, si la preuve est faite que promouvoir des romans français avec autant de moyens que des traductions, ça marche aussi, alors pourquoi diable leurs auteurs sont-ils toujours aussi peu payés ? Alors qu’acheter les droits d’une traduction à succès est une histoire de gros mais alors très gros sous, pourquoi cette persistance étrange, teintée d’injustice flagrante, à plafonner à-valoirs et surtout le pourcentage des droits pour les auteurs jeunesse français ? Pourquoi entend-on encore de la bouche des éditeurs que « 12 % ça ne se pratique pas en littérature jeunesse » comme si c’était un axiome indéboulonnable, alors qu’en littérature générale des auteurs débutants sont payés 10% avec des paliers à 12 puis 14% ? Je n’ose connaître les pourcentages pratiqués en littérature jeunesse dans les pays anglo-saxons, mais ça m’étonnerait fort qu’ils soient payés 6%. Pour mémoire, ce qui se pratique le plus souvent en France en littérature jeunesse c’est un démarrage à 6%, puis des paliers à 7, 8, parfois 9, et parfois ô miracle 10%. Un palier se franchit par exemple au-delà de 15 000 ventes, puis 25000, puis 35000, etc…. Autant dire que le risque pour l’éditeur d’en arriver à payer l’auteur au dernier palier est ultra-mince, et il ne s’agirait alors que de partager équitablement un beau succès ; cette résistance en est d’autant plus inexplicable.
J’ai peut-être en partie une réponse, et peut-être que là aussi il y a quelque chose à débloquer : une fois mon éditrice m’a dit, alors que je me demandais si j’avais le droit de rapporter une ligne ou deux d’une chanson anglaise dans mon roman : « oh de toute façon, les auteurs de la chanson ne s’en apercevront pas, ton roman ne paraîtra jamais chez eux ! » J’ai été un peu vexée, je dois dire. J’y crois à chaque fois, moi, que mon roman puisse être un jour traduit en anglais. C’est blessant que l’éditeur n’y croie pas une seule seconde. Mais c’est une réalité : nos romans français n’ont quasiment aucune chance de paraître dans un pays anglo-saxon. Et qu’est-ce que ça veut dire, concrètement, pour l’éditeur ? Qu’il ne recevra jamais de somme monumentale, même pour un best-seller en France, de la part d’éditeurs étrangers pour en acquérir les droits. Il ne peut pas compter là-dessus. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles on n’est pas si bien payé. On pèse peu sur le marché international (et bon, ça me vexe vraiment comme un pou).
C’est pourtant le dernier frein, ce frein financier important, pour que le talent des auteurs français en littérature dite pour la jeunesse s’envole et côtoie les cimes, encore bien davantage et plus souvent qu’aujourd’hui. Comment voulez-vous écrire un grand roman de qualité, ce qui prend du temps, on s’en doute bien, sans avoir suffisamment d’argent pour vivre ? On peut le faire, mais en faisant des prêts à la consommation, ou en s’épuisant après son « vrai boulot lucratif » le soir, ou en comptant sur le salaire de son conjoint si on a la chance d’en avoir un qui gagne suffisamment (en temps de crise, croyez-moi j’en connais peu), en tout cas toujours en vivant sur une corde raide. Et donc on ne peut pas, humainement, écrire un nouveau grand bon roman en restant plusieurs mois à écrire, c’est-à-dire sans rien publier, comme peuvent le faire les anglo-saxons dès le premier succès publié, logiquement puisque je le répète il faut du temps (et donc de l’argent) pour écrire un bon roman un peu consistant. Comment les éditeurs ne voient-ils pas qu’ils perdent de l’argent en nous payant si peu ? Si nous étions mieux traités, nous pourrions écrire de meilleurs romans en prenant davantage notre temps et ce seraient eux les premiers à en bénéficier. Et qui sait, les éditeurs anglais ou américains commenceraient peut-être à lorgner de notre côté ? Est-ce un doux rêve ? Je n’en suis pas certaine. Et je ne comprends pas que les éditeurs fassent un si mauvais calcul.
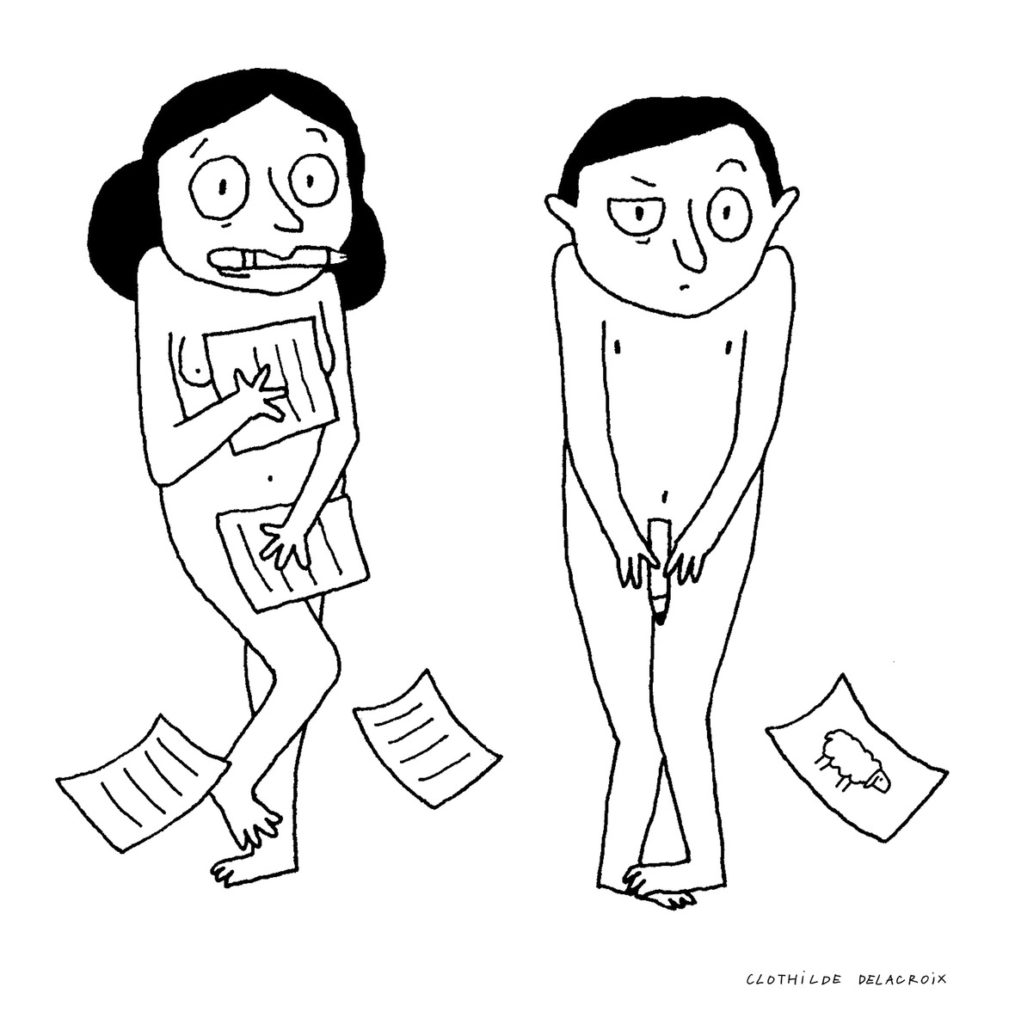
Il faut être sincère pour écrire un bon roman, il faut avoir du talent et faire preuve d’originalité, mais les auteurs anglo-saxons, protégés par leurs agents littéraires, beaucoup mieux payés que leurs homologues français, ont de bien meilleurs moyens et de plus grandes facilités pour déployer ces qualités.

Yes, Veronica Roth, you can.
NB (ajout du 10 octobre) : suite à des réactions sur Facebook où certains ne trouvaient pas légitime de se comparer aux américains dont le marché est beaucoup, beaucoup plus important, je précise que je ne souhaite pas des à-valoirs aussi important que les auteurs outre-Atlantique (quoique je ne les refuserais pas, hein !), mais un traitement juste proportionnel à l’échelle du marché français qui n’est tout de même pas minuscule. Et les pourcentages, eux, sont juste proportionnels à ce qui se vend, quelle que soit l’étendue du marché. Réclamer de meilleurs pourcentages quand ils sont trop bas, c’est juste demander une meilleure répartition de la « richesse », quelle qu’elle soit. Et si les pourcentages augmentent, mécaniquement ça augmentera les à-valoirs. C’est pourquoi mieux vaut, je crois, focaliser nos négociations toujours davantage sur les % (et éventuellement le tirage si on le juge trop bas par rapport aux ventes possibles). Les à-valoirs ne sont qu’un produit mathématique issu de ce pourcentage, du prix du livre et du tirage prévu. Ce tirage étant calculé en fonction du marché, il est tout à fait logique que nous n’ayons jamais d’à-valoirs aussi mirobolants que ceux des américains. Mais rien n’empêche qu’on ait les mêmes pourcentages qu’eux dans notre pays.
Lire aussi : L’impossible schizophrénie de l’auteur jeunesse.






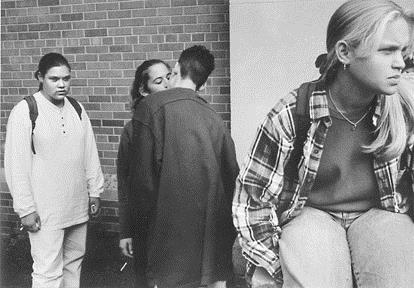

Kassandre Bathory de Kapolna
6 octobre 2016Après le petit succès des autodafeurs j’ai demandé (et obtenu) une augmentation de pourcentage, (je refuse de dire « réclamer » car je trouve la démarche normale) j’ai grapillé un petit quelque chose mais je suis encore loin des pourcentages adultes (et il y a des paliers…). Alors, oui, je confirme, ce n’est pas évident, il faut argumenter, ne pas se démonter, ne pas s’excuser, dire les choses et ne pas avoir peur de passer pour l’enquiquineuse du jour, mais je pense que nous aurions tous à gagner (éditeur compris) à oser demander systématiquement une réévaluation de nos droits. Peut-être qu’à force l’idée finira par s’imposer…
Merci encore pour ton billet.
FH
6 octobre 2016Je suis entièrement d’accord. Les choses ne bougent pas aussi à cause de notre propre peur de négocier. C’est drôle ce rapport à l’argent qu’on a, on a beaucoup de mal à considérer comme un dû ce que l’on nous doit pourtant. Faut qu’on se botte (tous) les fesses !
Césarine Mars
6 octobre 2016Tellement d’accord avec toi … Ce qui est fou c’est que nous sommes nombreux à tenir ce discours ( clémentine, Anne, Samantha et Guillaume ont même écrit des articles proches du tien) mais que rien ne change vraiment
FH
6 octobre 2016Le pot de terre contre le pot de fer… Mais aussi une posture de nombreux auteurs eux-mêmes (j’avoue que ce qui m’a inspiré cet article c’est surtout un énième discours d’auteur jeunesse qui dénigrait… la littérature jeunesse. Forcément ceux-là ne doivent pas beaucoup se battre pour leurs droits vu qu’ils méprisent le genre qu’ils écrivent eux-mêmes. Y’a beaucoup de masochistes dans la profession, ce qui rend notre lutte impossible).
Cyril
4 octobre 2016C’est sans doute même la première question à se poser, très profondément, avant d’écrire : suis-je sincère ? Ce qui nous amène à nous interroger ensuite sur notre motivation En tous cas, bravo. Et je m’abonne…
FH
5 octobre 2016Merci.
Sandrine
4 octobre 2016Mais tellement, tellement d’accord avec toi !
Merci pour cette démonstration brillante !
FH
4 octobre 2016Oh merci Sandrine. Puisse-t-elle faire un peu bouger les lignes…
Delphine Laurent
4 octobre 2016Florence Présidente! Merci!
FH
4 octobre 2016Oula, c’est gentil mais non, je ne souhaite être présidente de rien du tout ! Mais merci 🙂
Cécile
3 octobre 2016Clap clap ! bel article !
FH
3 octobre 2016Merci 🙂