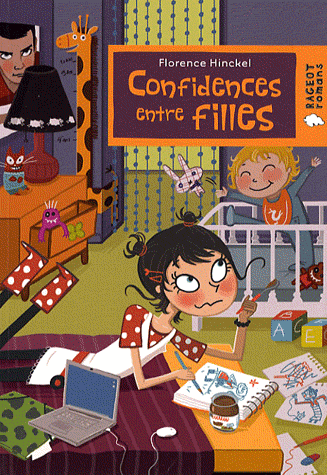De la photo prise le jour de son mariage, en 1931,

le photographe André Kertesz a choisi, pour qu’elle soit exposée, de recadrer l’image…


… afin de n’en garder que sa main posée sur l’épaule d’Elizabeth, sa femme, mais aussi la moitié de son regard à elle, qui le regarde lui de façon indirecte (photographie prise au retardateur), de façon amoureuse, et nous regardant nous public de la photo, troublé par cet amour. Le regard du photographe est absent du champ, car déjà tellement présent, dans ce recadrage ; regard amoureux, aussi, troublant, également.
(Tout se mélange un peu en moi, il y a aussi les représentations amoureuses de Monet pour Camille, jusqu’à sur son lit de mort aux mouvements semblables à ceux de la débâcle, et souvenirs aussi de la femme de Bonnard, tant aimée également, assoupie, indolente, dans son bain, toujours jeune.

 )
)
Je regarde l’image entière,

… un peu artificielle parce qu’endimanchée, dans laquelle transpire pourtant tout cet amour, qu’André a choisi de recadrer, suivant ce qui le touchait le plus, très certainement. Il existe plusieurs épreuves où l’on voit le tâtonnement des recadrages successifs, jusqu’au définitif, le plus efficace selon lui. Mais même le tâtonnement est beau : que garder de nous, mon amour ? Mais peut-être encore davantage : qu’en montrer au reste du monde ?


Je regarde ces images, tout en me disant que ce qui me touche moi dans l’image initiale est différent de ce qui le touchait lui.

Ce qui me touche infiniment, personnellement, c’est l’expression du visage d’André. Le regard, le sourire doux. Le double regard (photographe et sujet). Le double regard d’Elizabeth, qui porte davantage une intention, qui plonge dans André l’artiste, celui qui a appuyé sur le bouton du retardateur, l’André d’il y a dix secondes, dégagé de son enveloppe charnelle, qui désormais l’enveloppe de son bras. Elle sent son corps posé sur elle, mais elle voit aussi l’homme en dedans, celui d’avant, celui d’après, ses fantômes passés et futurs (c’est cela, l’amour). Mais on lit aussi dans son regard une ironie, un jeu de non-dupe : « je sais que tu risques de nous montrer au monde entier« , et dans le même regard : « j’entre chez vous, et en vous, ô public », reflétant ainsi avec bravoure la problématique constante de tout proche d’artiste, sous forme de douce résistance, ou de ferme docilité… car tout artiste est cannibale… ou vampire.

Touchée également par la naissance de ses cheveux à lui, et par le soin qu’il mit, auparavant, à les coiffer. (La naissance des cheveux des hommes est émouvante, je trouve, leur implantation, l’idée qu’ils poussent à chaque minute un tout petit peu, l’idée que le cheveu vit, et qu’il meurt, aussi – l’absence de cheveux peut ainsi, aussi, être émouvante).
Il me vient des idées de cadrage toutes personnelles (qui trahissent son discours, livré via son choix de cadrage à lui) :

Car il y a aussi la courbe de cette épaule, ronde, enveloppante et tournée vers elle. Accueillante, abandonnée, sans défense, sans méfiance. Et puis l’oreille aussi : je t’écoute, aimée.

Même sentiment très exactement avec la jambe fléchie, passée sous l’autre, qui menace de le faire basculer. Vers (sur) elle.

Dans la pose un peu factice, les deux mains prennent pourtant cet abandon naturel et confiant, dans la même direction. La main d’André frôle la cuisse d’Elizabeth. Il la caresse peut-être du pouce, doucement.

Il y a enfin les boutons soigneusement boutonnés. Et la cravate. Tout ce qui, après la photo, dans l’intimité, se dénouera, et tombera enfin à terre, en une pose désordonnée…

… tout comme l’état d’esprit dans lequel nous laisse son cliché.
(Elisabeth and I, série de photographies d’André Kertesz, souvenirs d’une exposition, et échos d’une réflexion sur le cadrage d’une oeuvre, et la lecture qui en est faite – réflexion sur la photographie applicable à la littérature)