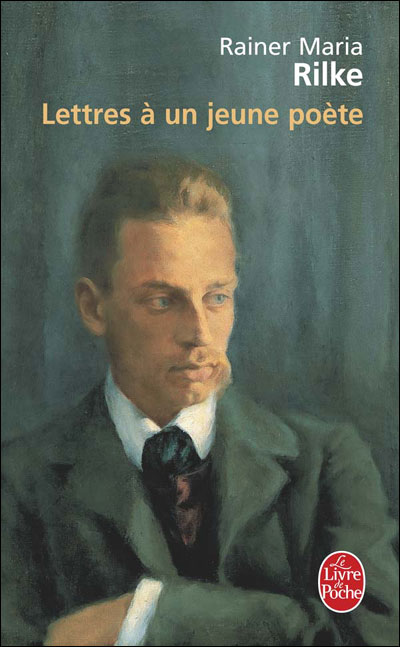Paris, le 17 février 1903.
Cher Monsieur,
Votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Je ne peux guère plus. Je n’entrerai pas dans la manière de vos vers, toute préoccupation critique m’étant étrangère. D’ailleurs, pour saisir une oeuvre d’art, rien n’est pire que les mots de la critique. Ils n’aboutissent qu’à des malentendus plus ou moins heureux. Les choses ne sont pas toutes à prendre ou à dire, comme on voudrait nous le faire croire. Presque tout ce qui arrive est inexprimable et s’accomplit dans une région que jamais parole n’a foulée. Et plus inexprimables que tout sont les oeuvres d’art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe.
Ceci dit, je ne puis qu’ajouter que vos vers ne témoignent pas d’une manière à vous. Ils n’en contiennent pas moins des germes de personnalité mais timides et encore recouverts.
Je l’ai senti surtout dans votre dernier poème: « Mon âme »
Là quelque chose de propre veut trouver issue et forme. Et tout au long du beau poème « A Leopardi » monte une sorte de parenté avec ce prince, ce solitaire. Néanmoins, vos poèmes n’ont pas d’existence propre, d’indépendance, pas même le dernier, pas même celui à Leopardi.
Votre bonne lettre qui les accompagnait n’a pas manqué de m’expliquer mainte insuffisance, que j’avais sentie en vous lisant, sans toutefois qu’il me fût possible de lui donner un nom.
Vous demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l’avez déjà demandé à d’autres. Vous les envoyez aux revues. Vous les comparez à d’autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Désormais (puisque vous m’avez permis de vous conseiller), je vous prie de renoncer à tout cela.. Votre regard est tourné vers le dehors; c’est cela surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne.
Il n’est qu’un seul chemin.
Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire : examinez s’il pousse ses racines au plus profond de votre coeur.
Confessez-vous à vous-même : mourriez-vous s’il vous était défendu d’écrire?
Ceci surtout : demandez-vous à l’heure la plus silencieuse de votre nuit: « Suis-je vraiment contraint d’écrire?»
Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse.
Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple: « Je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité.
Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d’une telle poussée.
Alors, approchez de la nature. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N’écrivez pas de poèmes d’amour. Evitez d’abord ces thèmes trop courants : ce sont les plus difficiles. Là où des traditions sûres, parfois brillantes, se présentent en nombre, le poète ne peut livrer du propre qu’en pleine maturité de sa force. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble.
Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le créateur rien n’est pauvre, il n’est pas de lieux pauvres, indifférents. Même si vous étiez dans une prison, dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée aux bruits du dehors. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n’essaierez pas d’intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d’une possession naturelle, qui vous sera chère, comme d’un de vos modes de vie et d’expression. Une oeuvre d’art est bonne quand elle est née d’une nécessité. C’est la nature de son origine qui la juge.
Aussi, cher Monsieur, n’ai-je pu vous donner d’autre conseil que celui-ci : entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend sa source. C’est là que vous trouverez la réponse à la question: devez-vous créer ? De cette réponse recueillez le son sans en forcer le sens. Il en sortira peut-être que l’Art vous appelle. Alors prenez ce destin, portez-le, avec son poids et sa grandeur, sans jamais exiger une récompense qui pourrait venir du dehors. Car le créateur doit être tout un univers pour lui-même, tout trouver en lui-même et dans cette part de la Nature à laquelle il s’est joint.
Il se pourrait qu’après cette descente en vous-même, dans le « solitaire » de vous-même, vous dussiez renoncer à devenir poète. (Il suffit, selon moi, de sentir que l’on pourrait vivre sans écrire pour qu’il soit interdit d’écrire.) Alors même, cette plongée que je vous demande n’aura pas été vaine. Votre vie lui devra en tout cas des chemins à elle. Que ces chemins vous soient bons, heureux et larges, je vous le souhaite plus que je ne saurais le dire.
Que pourrais-je ajouter ? L’accent me semble mis sur tout ce qui importe. Au fond, je n’ai tenu qu’à vous conseiller de croître selon votre loi, gravement, sereinement.
Vous ne pourriez plus violemment troubler votre évolution qu’en dirigeant votre regard au dehors, qu’en attendant du dehors des réponses que seul votre sentiment le plus intime, à l’heure la plus silencieuse, saura peut-être vous donner.
J’ai eu plaisir à trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. J’ai voué à cet aimable savant un grand respect et une reconnaissance qui durent déjà depuis des années. Voulez-vous le lui dire ? Il est bien bon de penser encore à moi et je lui en sais gré.
Je vous rends les vers que vous m’aviez aimablement confiés, et vous dis encore merci pour la cordialité et l’ampleur de votre confiance. J’ai cherché dans cette réponse sincère, écrite du mieux que j’ai su, à en être un peu plus digne que ne l’est réellement cet homme que vous ne connaissez pas.
Dévouement et sympathie.
Rainer Maria Rilke In, « Lettres à un jeune poète »