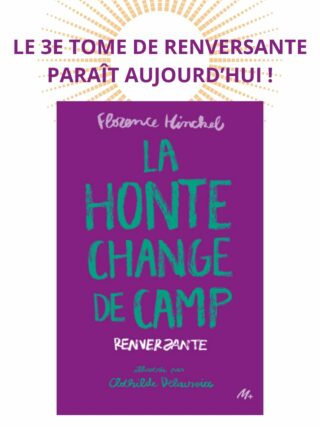30 juin 2008
Avatars feuillus fêtés par correspondance
Oui tout le monde dit qu’il fait trop chaud, moi je dis oui mais non, non non moi j’aime, je n’en souffre pas, au contraire, je mets des robes en toile de parachute, et puis je me répète je sais mais encore ce soir les martinets passent devant ma fenêtre, rayant les nuages roses de leurs cris et trajectoires circulaires ; l’air est doux après qu’on ait tant distribué de sueur, nos corps ruisselaient, parce que oui l’été c’est les corps, y’en aura pas que dans les transports en communion pas spirituelle, des corps, faut aller dans les fêtes, la peau brûle un peu, j’aime, ça donne bonne mine.
Il me semble enfin vraiment vivre, l’été. Corps sans entrave. Corps léger qui sautille au-dessus des trottoirs. Ah mais oui, grande intensité sous les feuilles, ça grouille pendant que le monde tourne autour du hamac, pendant que les livres volatilent devant les collines violettes et les oiseaux qui dansent.
Je me laisserai engourdir par la chaleur, y’a pas à lutter, oui oui je bouquinerai sous un ventilateur, mais je travaillerai aussi, peut-être le vrai travail. La vraie vie. Enfin du temps, alleluiah dieu est bon dans sa miséricorde devant le monde qui glisse sur un panier de cerises. Paraît que ça fait des tâches indélébiles sur les beaux atlas des parents. Ca fait même pas des formes de léopards. Peut-être de singes en été.
Les léopards se forment dans ma tête, puis z’imaginez pas mais leurs griffes se retrouvent dans mon ventre. Ca rugit bon sang de bois, ça étreint le coeur qui grandit sous le soleil, c’est connu, même sans arrosage (sauf un peu de muscat).
Quelque chose de physique pour écrire, non pas dans ce sens-là, c’est l’inverse, c’est écrire qui fait ressentir quelque chose de physique, je crois. Enfin pour moi c’est ça. Au départ ça peut être rien.
On écrit parce qu’on est vivant.
Ecrire maintient la tête au-dessus de la vie, au-dessus des feuilles, d’Apollo 13 et son café lyophilisé.
Bien éveillé.
Je serai pas hors des fêtes. Etre invitée à une fête, pour moi, c’est un cadeau formidable. C’est preuve qu’on pense à moi, qu’on aime que je sois là. C’est trop d’honneur. Comment pourrais-je refuser ?
Faire la fête, c’est une façon de bouger sur son chemin, tout en marchant sur le chemin des autres, un peu, très peu, c’est vrai, mais ensuite, la nuit, on entend les écureuils et les étoiles.
Les fêtes n’ont aucun sens, comme la vie.
Les fêtes, ce n’est pas la vitesse, bien au contraire. Pour moi c’est comme faire du sur-place. C’est être immobile mais bouger quand même. C’est peut-être même ne pas vraiment vivre, mais en tout cas c’est voir, et engranger. Souvent je me laisse penser – ma faiblesse – que j’y perds mon temps (je pourrais plutôt lire un bouquin, écrire un truc, avoir une vraie discussion longue et suivie avec un ami, ah la la), mais c’est un temps creux qui m’est cher, auprès d’êtres qui me sont chers. Un temps qui crée une place en moi pour d’autres choses, ensuite. Un creux, oui. Ensuite, quand il pleut, quand l’orage passe, quand les lectures se font, quand le sens arrive, le creux se mue en assiette, qui peut enfin se remplir.
C’est rester sous les feuilles, un temps. Remplir les rainures de sourires, rires, regards pétillants, d’amitié, de danse, de musique.
Puis rebondir avec une énergie incroyable vers la vie et notre formidable imaginaire créateur, celui qui nous permet de croire que la mort c’est la vie, que l’amour c’est l’amour, et toc.
Et écrire, enfin (mon repos à moi, mon abandon, mon hamac, mon midi à ma porte, avec un quatorze heures tourné vers les portes des autres).
Les correspondances sont bien vivantes.
25 juin 2008
Culture Internautique
Après Clarabel, Lily, c’est maintenant Florinette qui parle de La fille qui dort sur son blog !
C’est ici.
Un grand merci, Florinette. Je suis très touchée d’être ainsi lue, et que mes mots touchent à leur tour.
Je me répète peut-être, mais j’ai encore envie de rendre hommage à ces amoureux (en l’occurence amoureuses !) de la littérature, qui partagent ainsi leurs lectures sur le Net, suivant davantage leur plaisir que les influences médiatiques. Je crois bien que c’est Le Magazine Littéraire d’avril ou mai je ne sais plus, qui traitait ce phénomène, citant par exemple le blog de Clarabel, et parlant de culture indépendante.
Et là, une autre critique qui fait très plaisir, cette fois écrite par une libraire québécoise. Je ne sais pas si ça se fait, mais encore envie de dire merci !
24 juin 2008
Par la fenêtre

(Dorothea Lange)
22 juin 2008
La pose et l’envol


21 juin 2008
Ailleurs
(Dorothea Lange)

15 juin 2008
Willem De Kooning

11 juin 2008
Entre 11 et 12 : entracte réflexif
Après une escapade au parc, après une course effrénée, un pique-nique peut-être, après l’escalade des arbres aux branches les mieux réparties, après les égratignures aux genoux, la perte d’une montre neuve dans la pinède, après l’enterrement d’un oiseau, après avoir donné un nom au chat de passage, imaginé une discussion avec lui, après une danse animale déjà plus grave que celles d’avant, plus digne de celle des ours gracieux, on se trouve au sommet du muret de l’école pour que le chemin soit plus court, et soudain :
la vitre.
un reflet dans la vitre.
comme un ricochet.
sans les ondes autour.
Au dernier plan sont alignées sagement tables et chaises, tout semble mis en un ordre existant dans la seule attente d’une bousculade enfantine. Au premier plan, transparent, insaisissable, à quelques mètres de soi : un palindrome.
Un reflet. .telfer nU
(où se situe la vitre ? Au milieu ? Collée au reflet ? Contenant le reflet ?)
Et l’on s’interroge : est-ce vraiment soi ? Oui, à côté, dans l’image, il y a sa grande soeur, et un copain que l’on va bientôt oublier (qu’il se nomme Dimitri ou Irtimid), ça doit donc bien être ça. C’est cela, ce reflet étonné aux cheveux longs et noirs.
Et soudain, une fierté mêlée de crainte :
on ne ressemble plus à une fillette.
.ettellif ene à sulp elbmesser en no
Qui est la vraie ? Celle que je vois ou celle que je ne vois pas ? (Ma soeur semble surprise par ma réaction, ça l’agace).
Depuis ce premier reflet étonné, on ne cessera d’entretenir une relation très compliquée avec les miroirs, les vitrines dans les villes, et tous les regards.
Regards les tous.
Les regards tous.
Tantôt nous les rechercherons, tantôt nous les fuirons, tantôt ils nous saisiront par surprise.
Nous sursauterons.
Nous serons affreuses et sublimes.
Probable que tous les miroirs mentaient, mentent, mentiront.
Nous tenterons de saisir notre apparence avec un filet à papillons. Les mailles en seront serrées, tissées par nos soins, longuement, très longuement. Tous les soirs. Nos doigts en seront meurtris.
Expérience 1 : je mets un drap noir sur la psyché.
C’est immédiat : je disparais.
Expérience 2 : je colle des sparadraps sur le miroir, à l’endroit où se trouveront mes poignets et chevilles quand je reculerai.
Je recule : je ressemble à une page d’herbier.
Expérience 3 : même chose avec des épingles, pour voir si je ressemblerai à une planche de papillons.
Sous les coups de marteau, le miroir se brise.
Nous serons effondrées sous ces images qui ne seront plus des bons points. Une avalanche. Elle nous écrasera, broiera.
Nous tordrons nos reflets, nous en ferons le bastion de notre amour-propre, nous nous épuiserons à les rendre souple.
Puis.
Peu à peu, nous nous refléterons davantage dans les signes que dans les miroirs.
Peu à peu, les pages nous absorberont plus que le tain des vitrines.
Peu à peu, notre corps servira davantage à vivre qu’à paraître.
Peu à peu, nos gestes seront tendus vers les autres.
Peu à peu nous nous laisserons éparpiller.
Peu à peu, nous nous oublierons.
Nous laisserons couler.
Aimerons.
Alors, nous nous laisserons aimer.
Alors, nous choisirons une robe-qui-tourne.
Alors, être femme sera comme être fillette, simple et gai.
Alors, un jour, longtemps après, on surprendra à nouveau son reflet.
Alors, il aura à nouveau cet air étonné de la première fois, au sortir de l’enfance.
Alors, cet air sera heureux et craintif à la fois : comme lors d’une danse avec les ours.
Alors, nous serons à nouveau signes, pages, idées, désirs, envies et enthousiasmes : reines.
11
drome ?
On
pourrait
s’amuser,
faire
comme
si on
déroulait
une
bobine
sans fin.
(endless)
Sera-ce
alors
un
palin
10 juin 2008
Disse
Mais t’as sauté au moins 4 chapitres !
C’est que j’attendais que tu prennes la parole…
Je pouvais pas la prendre. Je sautais, mais elle était trop haute. A neuf et un dixième, Dimitri a réussi à bondir jusqu’à elle, alors j’l’ai attrapée. Faut qu’j’rattrape tout…
QUATRE + QUATRE
Pauvre, pôôôvre, pôôôôôôôvre petit oiseau mort… Tes ailes sont toutes lisses toutes lisses, liiiiissssses, ton bec tout petit minuscule. Ton coeur i doit avoir la taille de l’ongle de mon auriculaire, qu’on dit pour le ptit doigt. J’aimerais bien le voir, t’ouvrir le ventre avec la lame du couteau que Dimitri m’a montré un jour, il taillait l’écorce d’un bouleau. Mais je suis pas comme Vincent moi et si je fais ça c’est pour que tu gardes ton sang, je sais pas ptête que c’est important de garder son sang pour l’paradis des oiseaux, ptête que c’est mieux si t’es pas ouvert, si tu peux te présenter devant çui qui garde la porte du paradis des oiseaux tout entier pas dégoulinant, ouais ça fait mieux quand même.
J’ai pas de boîte tu sais, tu vas en bouffer de la terre, mais tu t’en fous t’es mort. Après tout c’est ton âme qui va monter, ton esprit ou chais pas quoi alors sang ou terre ou autre chose on s’en fout, jpeux même te cracher dessus si je veux ça ferait pas de différence au fond, mais ça se fait pas d’cracher sur les morts, même les oiseaux, ça s’fait pas, ptête qu’après j’irais en enfer ou jsais pas. C’est mieux, la terre tout de suite, je veux pas t’envelopper, pas te cacher, je veux que tout de suite tu sois dedans, que les grains s’insinuent dans les coins de tes plumes, que tu d’viennes très vite terre toi aussi pis hop on s’en moquera du sang après.
SET
(Le P il sert à rien)
J’aime bien voir mes ongles tout crasseux de terre.
SISSE
(Ce X c’est un faux en fin de conte)
J’enfonce mes doigts, j’fouille, j’creuse, j’laisse mes traces comme les bêtes, ce trou i pourrait aussi être pour moi, tiens ce serait drôle ça, si j’en faisais un aussi grand comme moi, et j’irai aussi, comme ça. Comme ça tu te sentirais moins seul, pauvre, pauvre, pauvre petite bête crevée. Encore heureux que t’es pas un lapin, on t’aurait dépecé je te dis pas comment, et après j’aurais dû te manger. Ouais j’t’aurais mangé, j’adore ça le lapin, c’est mou. Et puis tu serais devenu moi, et comme ça ben ouais j’aurais plus eu qu’à m’enterrer moi. C’est logique tout ça.
SINQUE
Tiens il bouge pus c’t’animal-là sur le bord du chemin.
Même si je le tâte du bout de mon pied, il bouge pus. I doit être mort c’t’oiseau-là. L’est mort comment je sais pas, ptête tombé, ptête malade, ptête tué. Y’a pas de sang. Si je le laisse là il va pourrir, et ptête que c’t’imbécile de Vincent va le trouver, et pis il va lui ouvrir le cou. Et là y’aura du sang. Pour pas qu’il saigne, je vais l’enterrer. Ah la bonne idée, je vais lui faire des vraies funérailles, des vraies de vraies, pleines d’émotion et de musique. J’serai le prêtre, pis je pleurerai comme si j’étais je sais pas ta soeur par exemple. Je fredonnerai si faut.
09 juin 2008
Racine ronde de 81
Non, pas encore l’adolescence, juste avant, lorsque l’amour n’est pas moins fort, bien au contraire, mais se place sur le même plan que l’observation, dans le soir avancé, d’un lézard ou d’un minuscule scorpion s’évadant après la pierre soulevée. L’empreinte du caillou est humide, et une racine de mimosa circonscrit une piste parfaitement sphérique.
Deux scarabées y font une révérence.
Dans le noir la minuscule fillette effectue seule des huit parfaits qui s’entrelacent sous les projecteurs des jonquilles. Puis elle figure le chiffre 1, car elle aime les débuts.
Un clown la regarde, et elle ne voit pas, pas encore l’humain sous le clown, mais seulement le clown qu’est l’humain. Ils se renvoient un sourire de tendresse infinie.
Puis elle saisit les trapèzes, suspendus à des tiges de magnolia qui poudroient par moment quelque pollen.
Son meilleur ami – ne vous en ai-je pas encore parlé ? Il s’appelle Dimitri -, en face, suspendu lui aussi à un trapèze, tend les mains. Il faut attendre longtemps avant que les doigts se touchent : ils se balancent des siècles à contre-temps. Lorsqu’enfin elle attrape le désir de ces bras, aux environs de l’invention des hiéroglyphes, elle reconnaît le clown de tout à l’heure. C’était toi ? C’est toujours moi. J’étais aussi le lézard, le scorpion et les scarabées. J’étais aussi la pierre. Le mimosa, les jonquilles et le magnolia. J’étais aussi les huits parfaits. Je suis aussi ce trapèze. Et – attends, je te dépose à terre -, regarde, maintenant, je suis un rat.
Il bondit dans la boue, et disparaît quelques secondes. Il revient ensuite lentement, sur les deux pattes arrière, un peu maladroitement. Les pattes avant lui servent à finir de sangler une petite selle en cuir qui lui enserre le ventre. Puis il émet un couinement que la petite fille comprend parfaitement. Rien de plus normal : c’est elle qui a inventé ce langage, il y a 3600 ans de cela. Elle grimpe sur la selle. A eux seuls ils créent une parade. Trois tours jusqu’à ce que la nuit soit bien noire, suivis par tous les insectes de la création.
Puis ils disparaissent au moment où les nuages commencent leur traditionnel chant d’invisibilité nocturne.
D’énormes gouttes dégringolent soudain, s’écrasent, éclaboussent.
La pierre posée non loin, le toit du chapiteau, sera une nouvelle arche de Noé, qui ne flottera point. Peu importe : les insectes volants porteront les rampants.
Seuls périront les mille-pattes, qui auront perdu trop de temps avec les lacets de leurs souliers trop lourds.
Dimitri, lui, n’a jamais bondi si lestement.