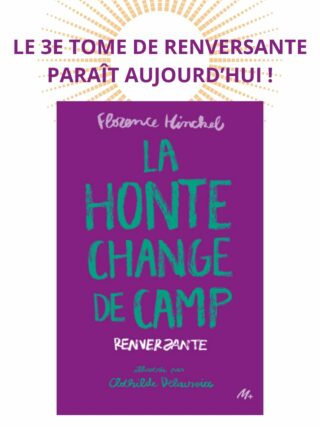30 janvier 2008
Vertu du café
Les minutes s’écoulent et se perdent en une fragrance cosmique. Gâchées, on le sait, perdues, à jamais. Aucune envie d’être piégé dans une autre dimension que celle-ci, la vraie. La quatrième est attirante, virtuellement séduisante, mais c’est la troisième que l’on veut toucher. Du doigt la caresser ou même la frapper, comme du plat de la main la gifler. La réveiller, la révéler. Etre soi devant l’éternité, devant ceux que l’on veut aimer. Vivre ces minutes avec intensité. Ne pas les regarder passer. En être maître, les manipuler. En faire ce qui nous fait rêver. Faire entrer la quatrième dans la troisième, entrer les rêves dans la réalité. Pour cela, se rencontrer. Devant un bon café (ou autre, hein).
29 janvier 2008
Et vlan, Vian !
Je mourrai d’un cancer de la colonne vertébrale
Ca sera par un soir horrible
Clair, chaud, parfumé, sensuel
Je mourrai d’un pourrissement
De certaines cellules peu connues
Je mourrai d’une jambe arrachée
Par un rat géant jailli d’un trou géant
Je mourrai de cent coupures
Le ciel sera tombé sur moi
Ca se brise comme une vitre lourde
Je mourrai d’un éclat de voix
Crevant mes oreilles
Je mourrai de blessures sourdes
Infligées à deux heures du matin
Par des tueurs indécis et chauves
Je mourrai sans m’apercevoir
Que je meurs, je mourrai
Enseveli sous les ruines sèches
De mille mètres de coton écroulé
Je mourrai noyé dans l’huile de vidange
Foulé aux pieds par des bêtes indifférentes
Et, juste après, par des bêtes différentes
Je mourrai nu, ou vêtu de toile rouge
Ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir
Je mourrai peut-être sans m’en faire
Du vernis à ongles aux doigts de pied
Et des larmes plein les mains
Et des larmes plein les mains
Je mourrai quand on décollera
Mes paupières sous un soleil enragé
Quand on me dira lentement
Des méchancetés à l`oreille
Je mourrai de voir torturer des enfants
Et des hommes étonnés et blêmes
Je mourrai rongé vivant
Par des vers, je mourrai les
Mains attachées sous une cascade
Je mourrai brulé dans un incendie triste
Je mourrai un peu, beaucoup,
Sans passion, mais avec interêt
Et puis quand tout sera fini
Je mourrai.
27 janvier 2008
Silhouettes et iris
Le cri d’un oiseau a déchiré l’air d’un coup d’un seul.
Mes journées sont le creuset d’images plus nettes. Ces temps-ci je vis mon pointillisme dans les pointillés, et non dans l’espace entre eux, ni dans un lien qui serait fait entre eux.
Le jour se ponctue d’images, d’objets et de sensations furtifs comme un vol de chauve-souris happée du regard dans un ciel vécu, lui, en une déferlante très fluide de points nommés.
Le jour en surimpression estompe les images d’un film vu la veille, ou celles d’un blog bien-aimé, dans lesquelles j’aime longtemps me vautrer.
Plus tard, l’image la plus marquante, je l’attrape dans ma voiture, bulle métallique et chérie – j’adore les temps de transport, instants de quiétude volés -. Il s’agit, sur le bord de la route, d’une chaise inoccupée. Elle est vieille et raccomodée au scotch brun et laid. Je sais qui elle attend.
Puis un parc. Image d’un grand arbre penché, cela n’enlève rien à sa force. Il s’élance vers le ciel dans une trajectoire originale. Il est beau.
Mots.
Ma convoitise comique, mon voeu glacé : saisir ta tête comme un rapace à flanc d’abîme. Je t’avais, maintes fois, tenue sous la pluie des falaises, comme un faucon encapuchonné.
Rêves et mots qui emplissent le coeur de soleil, comme s’il n’y en avait pas assez.
Sourires au monde.
Pensées bleues.
Les iris ont la forme de corps d’enfants. Fabuleux iris.
Matisse ? Pensées de silhouettes dansantes en papier déchiré, collé, couleurs franches.
Puis coups de fil, parler à des gens.
Café.
D’autres choses. La vie.
Retour dans la bulle mécanique, d’un pied léger. Tout me semble léger. Vitre ouverte, cheveux au vent, humer la vie semée, ensuite éclose.
Même route dans l’autre sens.
La chaise.
Sur la chaise, elle est là, comme toutes les autres.
La route est escortée de silhouettes. Leurs longs cheveux sont attachés. Relevés en chignon sur la nuque, on dirait des jeunes filles qui attendraient leur petit copain pour se rendre à la faculté. Tout simplement. Mais ce n’est pas tout simplement. Elles arpentent la pelouse qui borde la route, parfois je les vois qui me regardent. C’est de bonne guerre, c’est moi qui les regarde le plus souvent, tout le monde les regarde, c’est fait pour. Mais quand elles me regardent moi, c’est troublant. Que pensent-elles de moi ? Me méprisent-elles ? M’envient-elles ? Peut-être que je les laisse indifférentes ? Non, je ne crois pas.
Puis ce sont les bras potelés de mon amour forcené. Puis les longs cheveux dorés et virevoltants. Puis l’homme.
Le soir venu, les oiseaux ondoient. Par la fenêtre, je les imagine sans les voir. On ne peut pas toujours tout voir.
26 janvier 2008
Première du monde
à Pablo Picasso
Captive de la plaine, agonisante folle,
La lumière sur toi se cache, vois le ciel :
Il a fermé les yeux pour s’en prendre à ton rêve,
Il a fermé ta robe pour briser tes chaînes.
Devant les roues toutes nouées
Un éventail rit aux éclats.
Dans les traîtres filets de l’herbe
Les routes perdent leur reflet.
Ne peux-tu donc prendre les vagues
Dont les barques sont les amandes
Dans ta paume chaude et câline
Ou dans les boucles de ta tête?
Ne peux-tu prendre les étoiles?
Écartelée tu leur ressembles,
Dans leur nid de feu tu demeures
Et ton éclat s’en multiplie.
De l’aube bâillonnée un seul cri veut jaillir,
Un soleil tournoyant ruisselle sous l’écorce,
Il ira se fixer sur tes paupières closes.
Ô douce, quand tu dors, la nuit se mêle au jour.
Paul Eluard
25 janvier 2008
Les anges bégaient
« Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère », prononce Ange en scrutant le ciel. Il est étrange, Ange, il semble sorti d’un de ces romans dont il parle, il a toujours étonné, toujours, depuis le début de sa vie, qu’il traverse encore aujourd’hui sur la pointe de ses pas légers, comme sur un sol inconsistant. Là encore davantage, juché sur un rocher blanc, posé sur le sommet d’une falaise, les cheveux maltraités par une onde iodée aux gifles sadiques et intempestives. Par moments il lève les bras comme s’il voulait voler, il le pourrait, il ne pèse pas même le poids d’un oeuf de goéland pernicieux. Le pan de sa veste, lui, ne s’en prive pas, ça lui fait comme une aile, un filin raccordé à ses rêves de granit. Un jour, un dieu malicieux tirera dessus, et on le verra s’élever devant les nuages filandreux, les caresser de sa main fine et frêle, en prélever un morceau et l’enfourner avec le dégoût de trop d’envies. Puis disparaître. Il lâche le ciel à l’odeur de barbe à papa, pas ceux à pipe, pour provoquer l’océan blanc grand géant du regard gardé gaillardement jusqu’à présent. L’océan lui a toujours fait, effet de bel éternel recommencement, semence, semant, ment, ce genre de bégaiement, gai, décidément. Dément. Dé des moments mous et mouvants. Il est comme ça, Ange, il se plie lie rit devant les éléments ailés aimants, et laids et mandibules bulleuses tueuses rieuses. Troublant lent trouble trou blanc. Lent pour le bleu du houx bilieux rendu tremblant. Trente trembles bistres tristes mises sous cystes.
Ange, compris, j’ai compris, Ange est un ange né ange engendré des gens cendrés sans entrer dans des rais sans traits très étirés. Il s’est retiré.
*
* *
Connaissez-vous Gherasim Luca ? C’est un peu lui qui m’a inspiré le style de ce texte.
Il s’agit d’un poète surréaliste roumain. Vous pouvez l’écouter ici. C’est étonnant et beau, vous verrez :
http://editions-hache.com/luca/luca1.html
24 janvier 2008
Sidéré

Au moment où, à Rome et à Anvers, la peinture religieuse de la Contre-Réforme tourne au grand opéra avec Vierges pimpantes, prophètes élégants et martyrs heureux, Greco prend la voie opposée. De temps en temps, de façon inattendue, on le trouve plus près du Caravage que de tout autre contemporain. Ainsi est-il l’auteur d’une allégorie – il l’a peinte deux fois -, dans laquelle un adolescent allume une bougie à un charbon ardent. A sa gauche, un grand singe au poil gris, à sa droite, un idiot aux dents déchaussées, au rire inquiétant. A nouveau, on ne comprend pas exactement le sens. On reste simplement sidéré.
Davantage ici : http://v2.univarts.com/mag/article/561_le_greco_eternel_inattendu.html
23 janvier 2008
Epreuve de l’or
L’homme bon, ou fort, est celui qui existe si pleinement ou si intensément qu’il a conquis de son vivant l’éternité, et que la mort, toujours extensive, toujours extérieure, est peu de chose pour lui. L’épreuve éthique est donc le contraire du jugement différé : au lieu de rétablir un ordre moral, elle entérine dès maintenant l’ordre immanent des essences et de leurs états. Au lieu d’une synthèse qui distribue récompenses et châtiments, l’épreuve éthique se contente d’analyser notre composition chimique (épreuve de l’or ou de l’argile).
Deleuze, dans Spinoza, philosophie pratique
22 janvier 2008
Distance
On lit, on écrit, on regarde, on pense ou on lève l’ancre, pour que soi regarde soi, pour agrandir la distance, pour jauger son âme et la juger froidement.
On lit, on écrit, on regarde, on pense ou on lève l’ancre pour savoir ce qu’est aimer savoir ce qu’est vivre ce qu’est mourir. Pour savoir si l’on aime si l’on vit si l’on meurt.
On lit, on écrit, on regarde, on pense ou on lève l’ancre peut-être aussi parfois pour se détourner de soi chasser un sentiment-roi. Trouver les résistances les ultimes soutiens qui éloignent des brumes et des mauvais chemins.
On lit, on écrit, on regarde, on pense ou on lève l’ancre pour éteindre les passions tristes, pour sortir de la forêt ne pas la brûler et avec, se décomposer, tristesse engendrer.
On lit, on écrit, on regarde, on pense ou on lève l’ancre pour se sentir petit dépassé par l’art, l’amour ou la mort, regarder l’amour comme un tableau, à l’extérieur de soi et l’encadrer.
Mais parfois on ne lit pas, on n’écrit pas, on ne regarde pas, on ne pense pas, on ne part pas.
On vit, on vit, on vit, on vit, on vit.
Mais lire, écrire, regarder, penser ou prendre le large, ça n’agrandit pas toujours la distance, bien au contraire.
Je l’ai réalisé ce matin, lorsque j’ai écouté une musique emportante. Je l’avais oublié : écouter. L’art transperce parfois le corps et trouve le chemin le plus court vers le coeur.
Parfois, un livre, un film, une musique, un paysage ou une rencontre nous touche singulièrement. Parfois tant que les larmes viennent. On ne sait même pas d’où elles proviennent, d’abord. Le détour par la conscience n’a pas été emprunté. A vol d’oiseau, des signes magiques ont su atteindre l’âme et la cogner. L’ébranler.
On est touché. Le terme n’est pas anodin, lorsqu’on touche, la distance n’est plus.
L’art trouve le plus court chemin de soi à soi.
Parfois il nous arrive de rester de marbre devant un événement de la vie. On regarde les autres pleurer, autour. Ou rire. Et en nous, rien. Blindé.
Puis, quelques jours, mois ou année plus tard, on lit, on écrit, on regarde ou on écoute quelque chose qui brise le blindage, le traverse le transperce, à la vitesse de la lumière. Et alors, enfin, on pleure. Ou on rit.
Parfois l’art est un détour qui, paradoxalement, trouve le plus court chemin.
21 janvier 2008
Tentation
Le mot tentation est le plus souvent utilisé pour parler d’une attirance irrésistible vers un plaisir, une pulsion, un désir qui prend aux tripes, ou un vice.
Mais n’avez-vous jamais ressenti une autre sorte de tentation ? Rappelez-vous, elle ne dure qu’un millième de seconde. Elle est si fulgurante et dérangeante que vous l’oubliez aussitôt.
C’est, lorsque vous êtes sur un trottoir, et que vous allez traverser la route, regarder cette voiture qui arrive à une vitesse folle. C’est penser : j’y vais. Je m’y jette. Voir ce que cela fait. Un très très très bref instant. Puis se raviser.
Idem sur le quai d’une gare.
Dans le métro.
C »est, devant un feu, vouloir y plonger la main.
Sauter dans l’ascenseur, sans l’ascenseur.
Dans une étendue d’eau glacée, s’y paralyser.
Dans un puits tomber.
C’est vouloir ressentir son corps
Les os craquer.
Une douleur vraie.
Etre enfin sûr d’exister
Durant cette nano-seconde d’éternité
Puis
Etre soulagé de renoncer.
Planer au-dessus de la voiture
du train
du métro
du brasier
de l’eau glacée
du puits
oublier son corps
philosopher.
Qu’est-ce qui est le plus fascinant ?
La tentation ?
Ou ce qui nous fait résister ?
20 janvier 2008
Détails
Elle traversait la vie comme les enfants, sans jeter son regard au loin, où les lignes fuyaient ou se rejoignaient comme ces projets de l’existence concrète. Nous avons acquis cette habitude en passant le permis de conduire, il fallait regarder au bout de la route, afin d’anticiper voir prévoir. Souvenez-vous, au tout début, vous regardiez tout proche, effrayé lorsqu’une voiture vous frôlait, vous étiez prêt à toutes les embardées. Votre premier réflexe était de détailler le véhicule d’en face mais surtout son conducteur : homme ou femme, moche ou beau, jeune ou vieux, souriant ou renfrogné, etc… Vous étiez encore un peu enfant. Désormais, vous ne faites plus attention à cela. Vous êtes un adulte responsable qui regarde au loin.
Elle, non.
Elle l’avait passé, pourtant, le permis. Réussi au bout de cinq fois. Et elle était toujours terrifiée au volant. Elle n’imaginait toujours pas qu’on puisse partager la route avec des gens dont on ne pouvait pas discerner le visage. Impensable.
Alors, elle marchait.
Avec cet air troublant, semblable à ce portrait peint par Anto Carte.
En regardant partout autour d’elle. Emerveillée par ce brin d’herbe dans une faille du goudron, cet emballage de papillote brillant, cette chenille processionnaire à moitié écrasée, cette écorce compliquée, ce nom sur la sonnette argentée, ces flaques d’ombre à terre, d’eau brillante dans les cavités… Son esprit, alors, miroir où tournaient les nuages, où les ombres dansaient comme des mouettes, se reflétait dans ces détails. Elle ne pensait pas avoir grande conscience d’elle-même, mais du cosmos l’entourant, elle savait qu’elle en était un atome infime mais quelque peu signifiant, elle en souriait, un sourire d’une beauté cristalline, d’une intensité irisée. Ce qu’elle eût aimé, c’était découvrir incrustée dans le sol la pierre incandescente issue d’un minerai oublié. Une pierre diamantée qui diffuserait les reflets de son âme entière, celle qui l’entourait, et celle en dedans. En la tenant dans sa main, elle se réunirait. Les fragments dispersés là, là ou là se rejoindraient dans le caillou merveilleux. Enfin l’ordre du monde lui apparaîtrait, les signes auraient du sens, et elle pourrait se promener sur la route, au milieu, et tenter de distinguer les traits de chaque occupant de chaque véhicule, sans craindre la dureté du métal.