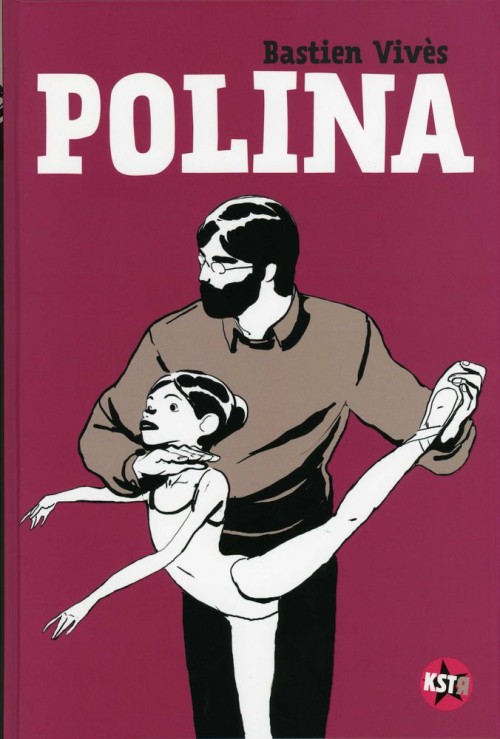Durant une longue période je n’écoutais plus France Inter que je trouvais pas terrible terrible. Mais depuis quelques temps, je suis heureusement surprise quand je l’écoute certains matins. Notamment par l’émission Sur les épaules de Darwin, avec un extrait aujourd’hui qui m’a donné des frissons (bon, au bord des larmes, mais je pleure pour pas grand-chose ces temps-ci). Je ne l’ai pas retrouvé entièrement mais en voici un bout (si quelqu’un veut m’offrir le bouquin pour Noël, c’est pas de refus 🙂 Il a l’air éblouissant, peu de le dire) :
« Mes parents étaient la protection, la confiance, la chaleur. Je l’éprouve encore aujourd’hui quand je songe à mon enfance, cette sensation de chaleur au-dessus de moi, derrière moi, autour de moi, cette impression merveilleuse de ne pas vivre à son compte, mais de s’appuyer tout entier, du corps et de l’âme, sur d’autres vies qui acceptent.
Mes parents me portaient.
C’est sans doute pourquoi, pendant toute mon enfance, je n’ai pas touché terre.
Je pouvais m’éloigner, revenir, les objets n’avaient pas de poids, rien ne collait à moi. Je passais entre les dangers et les peurs comme la lumière à travers un miroir.
Et c’est cela que j’appelle le bonheur de mon enfance.
C’était une armure magique qui, une fois posée sur vos épaules, peut être transportée à travers votre existence entière.
Mes parents, c’était le ciel.
Je ne me le disais pas clairement. Ils ne me le disaient pas non plus. Mais c’était une évidence.
De là mon audace. Je courais sans cesse. Toute mon enfance s’est passée à courir…
Seulement, je ne courais pas pour m’emparer de quelque chose (que voilà bien une idée d’adulte et non d’enfant !…). Je courais pour aller à la rencontre de tout ce qui était visible et de tout ce qui ne l’était pas encore. J’allais de confiance en confiance, comme dans une course de relais.
J’étais convaincu que rien ne m’était hostile, que les branches auxquelles je me suspendais tiendraient bon, que les allées, même sinueuses, me conduiraient là où je n’aurai pas peur, et que tous les chemins me ramenaient vers ma famille.
Autant dire que je n’avais pas d’histoire, sinon la plus importante de toutes, celle de la vie.
Et voilà ce que, tout à l’heure, j’ai appelé l’eau claire de mon enfance. […]
Ce qu’une maman peut faire pour son enfant aveugle peut s’exprimer simplement : lui donner naissance une deuxième fois.
C’est ce que la mienne fit pour moi.
Mon seul travail à moi était de m’abandonner à elle, de croire ce qu’elle croyait, de me servir de ses yeux chaque fois que les miens me manquaient.
A la compétence, elle ajouta l’amour, et l’on sait bien que cet amour là dissout les obstacles mieux que ne le feraient toutes les sciences.
On sait que j’avais de bons parents.
C’est à dire non seulement des parents qui me voulaient du bien, mais des parents pour qui ce n’était pas nécessairement une malédiction [que je sois] différent des autres.
Des parents prêts à admettre que leur manière de voir, la manière commune, n’était peut-être pas la seule possible, des parents prêts à aimer la mienne [ma façon de voir] et à la favoriser.
Jacques Lusseyran. Et la lumière fut.