Parfois il arrive que, dans une discussion avec des élèves ou des profs, à propos de l’égalité garçons-filles, je fasse une réponse qui moi-même ne me satisfait pas.
Je vais ensuite y réfléchir pendant des jours. Qu’aurais-je dû répondre ?
C’est arrivé il y a quelques jours, avec une prof doc qui m’a accueillie dans son collège pour rencontrer une classe de 4e.
Rencontre peu productive, avec des garçons butés-mutiques et des filles zombies.

La prof m’explique, comme je m’en doutais, que les garçons sont en fort rejet quant à la problématique de l’anti-sexisme. La prof de français renchérit en disant que, bon, ils en ont un peu assez qu’on leur parle de ça depuis la 6e. L’établissement enchaîne les projets sur la question, et certains ont une impression de rabâchage, à force. Mince, je n’avais pas pensé à ça. Moi qui arrive souvent comme l’extra-terrestre, première véritable féministe assumée que les élèves ont jamais rencontrée, voilà que j’apprends que je peux être perçue comme l’énième égalitariste qui vient encore leur casser les noix, heu, les pieds. C’est une évolution que l’on peut considérer comme positive, me dis-je. Sauf qu’apparemment, 3 années de rabâchage n’ont pas produit d’élèves féministes, mais des élèves rétifs au féminisme. Qu’est-ce qui a bugué ?
– Peut-être ne faudrait-il pas parler de féminisme ? suggère la prof doc. Trouver un autre mot ? Les garçons ne se sentent pas concernés, voire agressés, avec ce terme.
Elle et la prof de français s’étaient quasiment excusées, parce que le travail fait avec cette classe tournait autour de ce que la lutte contre le sexisme pouvait apporter aux garçons, afin qu’ils comprennent en quoi ce combat pouvait être aussi le leur. Davantage voir ses enfants et travailler moins, par exemple, ou encore ne plus avoir à payer le restaurant au premier rendez-vous faisaient partie de leurs rares trouvailles (avoir la satisfaction de voir sa mère, sa soeur, sa future fille ou même soyons fou sa future femme vivre mieux ne faisait hélas pas partie de la liste, mais l’empathie ne s’apprend pas en cinq minutes, ni même en 3 ans apparemment, et c’est bien là que le bât blesse, quand on ne parvient à éveiller l’intérêt des garçons qu’en flattant leur penchant à voir leur intérêt en tout, sans quoi balec).

J’ai eu une pensée émue et furtive pour les filles zombies, tout en comprenant totalement les profs. Il faut bien tout tenter. Prendre le sujet par tous les bouts possibles. Et puis il est très vertueux qu’on ait enfin compris qu’il faille éduquer les garçons avant de prévenir les filles. Bref, s’adresser aussi aux garçons, essayer de les rallier à la cause par tous les moyens possibles, même si c’est parfois maladroit : bonne idée ! Voilà où j’en étais de la réflexion – tout en me disant que bon sang, les profs étaient bien seuls, sans aucune aide ni guide d’aucune sorte dans leurs projets où bien malgré eux, malgré elles, nez sur le guidon, sans le vouloir c’est la reproduction d’un ordre inégal qui tient lieu de bousculade spirituelle.
Ainsi, en parfaite empathie avec ces profs qui se démènent pour intéresser les garçons, je m’entends répondre :
– Oui, peut-être, c’est vrai. Peut-être qu’on serait plus efficace, maintenant, si on parlait seulement d’égalitarisme.
Hochements de tête.
Nausée naissante me concernant.
Quelque chose n’allait pas. Je venais de dire quelque chose qui ne m’allait pas.
Cela me travaillera pendant des heures, où je retournerai ces questions :
☞ Quelqu’un, un jour, a-t-il demandé à ne plus parler d’« antiracisme » sous prétexte que cela éloignait les personnes blanches de cette lutte ? A ne plus parler de « validisme » sous prétexte que cela gêne les valides ? Et puis tenez, ne parlons plus d’humanisme, cela risque de blesser les non-humains. Parlons d’égalitarisme, qui ne nomme ni dominés ni dominants !
☞ Or si l’on n’entend plus, dans le terme qui désigne la lutte antisexiste, la catégorie de personnes qu’il faut défendre, ne sera-ce pas une énième invisibilisation, doublée d’un fort déni ?
☞ Parler d’égalitarisme, ce serait une parade très pratique pour prôner une idéologie floue qui ne met à jour aucun système de domination, non ? On peut se gargariser d’égalitarisme pendant des années sans que rien ne change, puisque rien ne sera jamais pointé.

Et c’est une grande spécificité de l’Education Nationale, ça. C’est même un parti pris. L’Education Nationale dans son ensemble se gargarise d’« égalité garçons-filles », mais pour elle, le terme « féminisme » est encore un gros mot. Pas de féminisme dans les programmes. C’est assez pratique d’occulter et invisibiliser tout le mouvement et toutes les militantes qui ont permis d’en arriver à ce que les filles aient enfin le droit de passer le bac, pour faire croire que ces progrès sont advenus par l’oeuvre de la Sainte-Laïcité, et qu’on va continuer à progresser par le même miracle, abracadabra.
On peut ainsi enchaîner les projets sur l’égalité garçons-filles sans jamais avoir à dézinguer le système, ce qui, avouez-le, serait fort dangereux. On ne pourrait même plus mettre un suppôt de Stanislas à la tête du ministère, et Darmanin devrait démissionner !

Pardon, chères profs, je me suis gravement trompée, je me suis même totalement reniée en faisant cette réponse molle et consensuelle.
Il FAUT brandir le mot féminisme haut et fort, justement parce qu’il est révolutionnaire, sans quoi rien ne changera jamais.
Et j’aimerais que toutes, on l’utilise fièrement, pour que la fantastique énergie déployée dans ces multiples projets « pour l’égalité garçons-filles » ne reste pas vaine. Si les élèves en ont assez, de tous ces projets, si bien qu’ils finissent par regarder la énième « égalitariste » de service comme des poissons dans leurs bocaux, c’est bien parce que pour eux tout cela reste à l’état de vent qui passe sur leurs peaux, parce que ces bonnes paroles n’ont aucun écho dans le monde extérieur, ni politique, ni familial, ni médiatique, ni sociétal, parce qu’ils tournent en rond encore, et encore, et encore.

Je comprends qu’on veuille rallier les garçons à la cause, en les englobant dans le mot d’égalité. Je comprends qu’on craigne de les en exclure par un terme où ils ne se retrouvent pas. Mais songeons à tous les endroits où ils se retrouvent déjà, où la cause masculine est exaltée, survalorisée, enracinée, favorisée. Les garçons peuvent déjà se projeter à la tête de l’Etat, des plus grands groupes privés, ils savent qu’ils seront mieux accueillis et représentés dans le monde du cinéma et de la culture en général, ils savent que leur voix pourra porter, que la justice les croira davantage en cas de violence sexiste et sexuelle, ils savent que la langue française elle-même parle d’eux comme du genre humain dans son ensemble, et tout cela certes dans une bien moindre mesure s’ils ne sont ni blancs ni valides ni de milieu favorisé, mais tout de même davantage que les filles non blanches et/ou handicapées et/ou de milieu défavorisé.
Aussi survivront-ils certainement à un terme où, pour une fois, on ne les « voit » pas.
Peut-être même pourraient-ils se décentrer un peu pour se sentir concernés par ce terme politique qui met en avant d’autres qu’eux, peut-être pourraient-ils en parler, au lieu de rester butés, mutiques, jambes écartées et bras croisés en forme de je-suis-bien-là-comme-je-suis-et-rien-ne-changera, alors parlez-d’égalité-si-ça-vous-chante-rien-à-foutre-ça-veut-rien-dire. Le problème est bien là, en ce qu’ils ont raison, ce terme ne veut rien dire puisqu’il n’existe pas encore dans les faits. Comment enseigner ce qu’on ne connait pas soi-même en tant qu’homme ou femme prof et qu’on n’a jamais connu ? Enchaîner sans fin des « projets » qui n’aboutissent jamais, quel sens cela a-t-il ? Peut-être cessons de parler de projet, pour parler de réalité. Enseignons la réalité de l’inégalité garçons-filles, enseignons l’histoire des femmes et des féministes, pour mettre les pieds dans le plat et avancer mieux. Et vous savez ce que c’est, le constat de l’inégalité garçons-filles en vue d’enfin atteindre une réelle égalité, dans la vraie vie, au-delà du seul projet qui semble n’avoir pour seul but que de rester à tout jamais un projet ? Bingo, le féminisme. Et uniquement lui.
Et peut-être aussi, que, si on parle enfin de féminisme, les filles zombies relèveront la tête, quoi, on m’appelle ? leurs regards s’allumeront, quoi, on parle de moi ?, et peut-être qu’elles cesseront de se retrouver effacées, zombifiées, encore, encore elles, par le rejet d’un mot qui les désigne, le joli mot de femme, qu’englobe ce terme fort et si puissant qu’est « féminisme ».


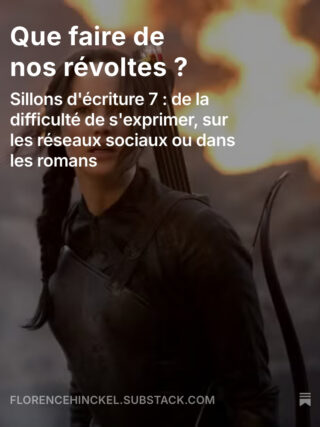



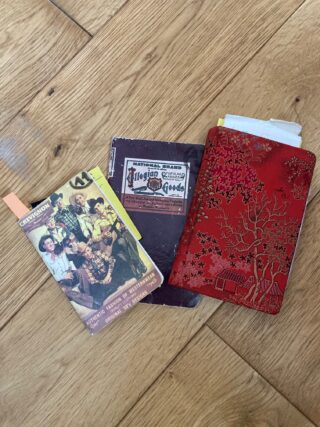
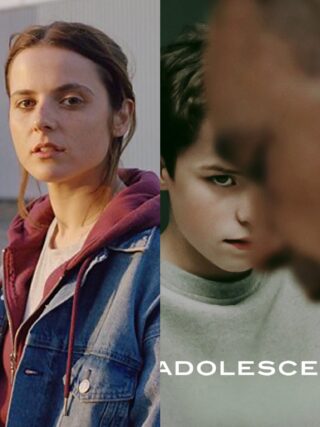


Stéphanie
15 avril 2024Bravo Florence !
Comme tu le dis, céder sur les mots, c’est toujours capituler sur le fond (« ajouter au malheur du monde » comme disait l’autre). Ce n’est pas le mot « féminisme » qui met en rage les sexistes, c’est l’idée même d’égalité totale entre les femmes et les hommes. Comme aurait dit ma grand-mère, plus ils sont «bêtes à manger du foin » (j’espère que cette formule ne blessera pas nos amis herbivores…), plus ils se croient supérieurs aux femmes. Et quand des femmes se comportent comme des inférieures, les hommes sont renforcés dans la conviction que leur domination est légitime. Éviter le mot féminisme parce que ça blesserait ces pauvres biquets, c’est céder d’avance à tout ce qui suivra, et c’est légitimer leurs propos et leurs actes sexistes. Les hommes peuvent-ils prendre leur place dans ce combat ? Oui, mais en apprenant à écouter les femmes (au lieu de leur expliquer comme souvent, avec arrogance, comment lutter…), en reconnaissant tous les privilèges de genre dont ils bénéficient dans notre système patriarcal et en affrontant à nos côtés les hommes sexistes (la majorité).
FH
1 mai 2024Merci et oui on est tout à fait d’accord chère Stéphanie ! Ce combat est tellement éreintant, ça fait plaisir de tels commentaires, merci.
Sophie Adriansen
11 avril 2024Merci pour ce texte, Florence, fort utile en cette ouverture de saison des rencontres 🙂
FH
12 avril 2024Merci Sophie !