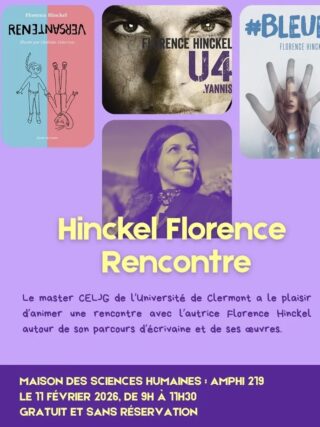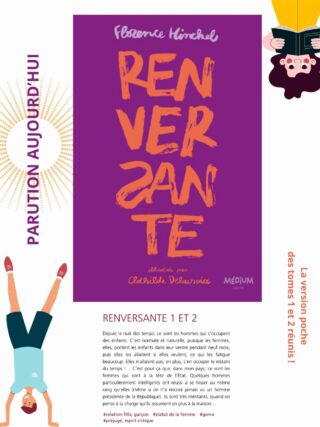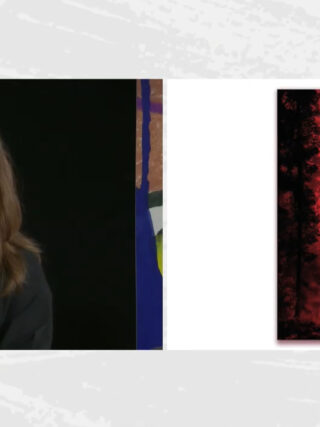Au sortir du salon jeunesse tout à l’heure, il neigeait dru, à nouveau.
Le ciel est tout blanc, c’est quelque chose que je ne me souviens pas avoir vu, une ville sous la neige, les tours floues, longues sihouettes aux contours escamotés, tout comme une de ces bulles pour touriste, on secoue et puis les flocons. Le salon du livre, c’est comme tout le temps, en plus grand. J’aime toujours le regard des enfants qui feuillettent, et leurs mots, souvent zozottés, j’aime la timidité des ados, avançant une main vers un livre comme s’ils devaient allumer la flamme d’une bougie, doucement. Cela seul m’émerveille, mais c’est une denrée rare, très calme le salon cette année, ensuite je m’en vais, dans la neige, vers la beauté sans paraître, il y a ce jeu auquel je ne sais plus jouer, 1 2 3 soleil, surtout par ce temps, rester immobile sans bouger, attendre qu’on me voie bouger, je bouge déjà, quelques flocons tombent de mes cheveux, mais secouez-moi pour qu’il y en ait comme un nuage en suspension, je pense à ce que je vais écrire, puis je vous souris, vous serre la main, mais ce que je vais écrire, ce qui est là puis pas encore couché, ce qui est là entre nous, je vous parle de moi, je vous écoute, je vous aime, les gens, les lecteurs, les enfants, les ados, mais ce que je vais écrire, et parfois, une véritable rencontre (mais surtout hors-salon, rencontres avec les oeuvres, dans les musées, rencontre avec le paysage, rencontre avec l’image des passants auxquels je ne parle pas, et les regards de ceux de la rue, ceux qui ont vraiment froid). Rien que pour cela, pour la surprise, si ça se trouve, dans un pli du jour ou d’un soir, calfeutré, être là, je suis là, je vous guette, vous vois qui que vous soyez, ici, Paris.
*****
J’ai trouvé le cinéma, c’était à Beaubourg, tout près du centre aux merveilles, il neigeait encore, les tubes aux ascenseurs paraissaient verglacés, pensons aux limaces, ça devait glisser, puis cela se transforma en pluie. Mouillée, j’avais plus froid encore. Alors le bonheur commença dès l’entrée dans le cinoche bien chauffé.
Il se poursuivit durant une heure et demie, devant la vraie beauté de la vie, via des adolescents superbes, ah les robes colorées, les escarpins rouges, les lèvres peintes comme des divas, ah les costumes sombres et les claques qui claquent, ah les caresses, les frôlements, les cris, les pépiements, les rires graves. Les pudeurs et les désirs, les surprises et les chocs. L’amour connu ou pas encore, deviné donc joué. Les chagrins, les rêves.
Un concentré de vie, de retenue puis de lâcher prise magnifiques.
Difficile de devoir faire autre chose après ça, on aimerait rester avec ces images et ces jeunes gens, longtemps, longtemps, avec Pina…
****
Le froid était vif. Derrière moi,des joggers. A Paris les gens courent par tous les temps. Même par celui-ci. D’autres buvaient un café sur les terrasses extérieures des bistrots. Des courvertures polaires posées sur les chaises, de toutes les couleurs, attendaient les clients, penaudes sur les dossiers. Je m’y suis imaginée un instant, enveloppée dans une polaire bleue pétrole, mais ce désir ne dura qu’une seconde. Il fallait bouger. J’ai voulu aller au Musée d’Art Moderne, voir l’exposition de Larry Clark, mais la file d’attente était décourageante. Comment attendre aussi longtemps sans geler ? Ils étaient là pourtant, les touristes, serrés les uns contre les autres de cette drôle de façon, sans se toucher pour autant. J’ai alors tenté le musée d’Orsay, mais là se pressait une foule véritable. J’ai regretté les trésors inaccessibles au-dedans, que je ne verrais pas cette fois, pas comme l’autre fois. La grande horloge m’adressa un clin d’oeil rapide, de l’extérieur. Elle gardait les trésors, malgré le temps qui passe. Inquiétude toutefois.
Je marchai encore, le long de la Seine, des cartes postales, des vieux livres, des bouquins comme on dit – bouquinistes, des affiches rétro. Un couple visiblement tombé à l’eau était assis sur un banc de pierre, au bord du fleuve, enveloppé de couvertures de survie étincelantes, entouré de pompiers, de plongeurs en combinaison. Que s’était-il passé ? Je ne pouvais que supposer, ignorante de leurs vies. Une dispute ? Un malaise ? Un déséquilibre ? Une chute ?
Je n’ai pas fait attention, simplement je longeais l’eau, absorbée par ses mouvements, ceux des passants. Puis soudain je me suis retrouvée là.
****
Je ne trouve pas sur le Net la photographie de L’enfant à l’arc, vue dans l’expo d’André Kertesz au Jeu de Paume. J’aurais aimé la poster ici. J’aimais la pose, la tension, surtout le regard.
Au lieu de cela, voici une photographie de Larry Clark, l’expo que je n’ai pas vue. La seule image faite par lui, trouvée sur la toile, qui me plaise. La seule qui me dise quelque chose. La seule de lui qui me point (relu dans le train La chambre claire de Roland Barthes, et il y a aussi dans cet ouvrage, en filigrane, un très bel amour pour sa mère défunte, qu’il compare beaucoup à celui de Proust pour la sienne, et aussi pour sa grand-mère dont je me suis souvenue le passage où elle se fait photographier, se parant auparavant d’une belle toilette, paraissant fuir le narrateur proustien, causant en lui une souffrance).
La chambre claire est un ouvrage mélancolique où plane une forme de douleur et la Recherche du Temps mais aussi du visage perdus, captés dans leur non-vérité, un jour, au jardin d’hiver, et depuis cherchés dans le punctum des autres images, toutes les autres.
*****
De la photo prise le jour de son mariage, André Kertesz a choisi de recadrer l’image afin de n’en garder que sa main posée sur son épaule, mais aussi le regard d’Elizabeth, sa femme, le regardant lui de façon indirecte (photographie prise au retardateur), de façon amoureuse, et nous regardant nous public de la photo, troublé par cet amour. Le regard du photographe est absent du champ, car déjà tellement présent, dans ce recadrage ; regard amoureux, aussi, troublant, également.
(Tout se mélangeait un peu en moi, il y avait aussi les photographies amoureuses de Monet pour Camille, jusqu’à sur son lit de mort aux mouvements semblables à ceux de la débâcle, et souvenirs aussi de la femme de Bonnard, tant aimée également, assoupie, indolente, dans son bain, toujours jeune).
Je regarde l’image entière, un peu artificielle parce qu’endimanchée, dans laquelle transpire pourtant tout cet amour, qu’André a choisi de recadrer, suivant ce qui le touchait le plus, très certainement. Dans l’exposition, on voit le tâtonnement des recadrages successifs, jusqu’au définitif, le plus efficace. Mais même le tâtonnement est beau : que garder de nous, mon amour ?
Je regarde ces images, tout en me disant que ce qui me touche moi dans l’image initiale est différent de ce qui le touchait lui.
Ce qui me touche infiniment, personnellement, c’est l’expression du visage d’André. Le regard, le sourire doux. Le double regard (photographe et sujet). Le double regard d’Elizabeth, qui porte davantage une intention, qui plonge dans André l’artiste, dégagé de son enveloppe charnelle, qui pourtant l’enveloppe de son bras. Elle sent son corps posé sur elle, mais elle voit uniquement l’homme en dedans.
Touchée également par la naissance des cheveux, et par le soin qu’il mit, auparavant, à les coiffer. (La naissance des cheveux des hommes m’émeut, pour une raison inconnue, leur implantation, l’idée qu’ils poussent à chaque seconde un tout petit peu, l’idée que le cheveu vit, et qu’il meurt, aussi).
Oh la courbe de cette épaule, ronde, enveloppante et tournée vers elle. Accueillante, abandonnée, sans défense, sans méfiance. Et puis l’oreille aussi : je t’écoute, aimée.
Même sentiment très exactement avec la jambe fléchie, passée sous l’autre, qui menace de le faire basculer. Vers (sur) elle.
Dans la pose un peu factice, les deux mains prennent pourtant cet abandon naturel et confiant, dans la même direction. La main d’André frôle la cuisse d’Elizabeth. Il la caresse peut-être du pouce, doucement.
Il y a enfin les boutons soigneusement boutonnés. Et la cravate. Tout ce qui, après la photo, dans l’intimité, se dénouera, et tombera enfin à terre, en une pose désordonnée.
_ _ _ __________________________________________ _ _ _
Sentiment de résistance inconsciente (mais de moins en moins) face à ce que l’on attend de moi (de mes textes – car s’il y a quelque chose qui se passe en ce moment, c’est cette impression que l’on « m’attend »). Après discussion avec deux éditeurs importants en littérature jeunesse, lundi, j’ai compris quelque chose. Quelque chose que je dois accepter, ou pas. Disons que je dois accepter si je veux être éditée chez eux (et, ne nous voilons pas la face, je le veux, car ils publient de la littérature de qualité). C’est quelque chose de l’ordre du lâcher-prise. Je sens une barrière que je n’ai jamais voulu franchir dans mon écriture, celle d’une plongée dans la profondeur des sentiments simples, communément reconnus. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’hormis le rire, réaction que j’aime susciter dans mes histoires pour enfants, mais aussi pour ados, et qui ne me pose aucun problème, j’ai du mal à susciter, sciemment, d’autres émotions (parce que je ne sais pas les définir). Or, pour les ados, c’est ce qu’attendent les éditeurs : des larmes, des sentiments coups de poing. Un bouleversement quoi qu’il en soit. Jamais je n’ai abordé de front l’amour, la peur, la violence (mais qu’est-ce que tout cela, véritablement ?)… La quête identitaire, oui, toujours, et toujours sans réponse. Mais voilà que je comprends que les éditeurs désirent pour les lecteurs des réponses. Or, je n’en ai pas. Je ne sais pas écrire avec mes poings. Je sais écrire avec mon coeur, mais toujours au bord de celui-ci, jamais en débord. Je ne sais pas, si, de ce fait, mon chemin sera plus long.
****