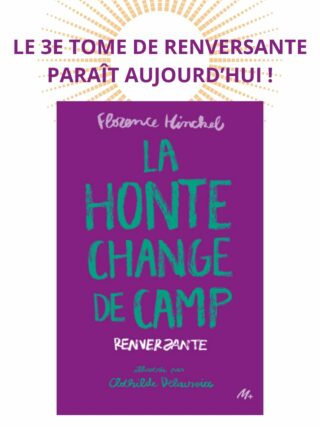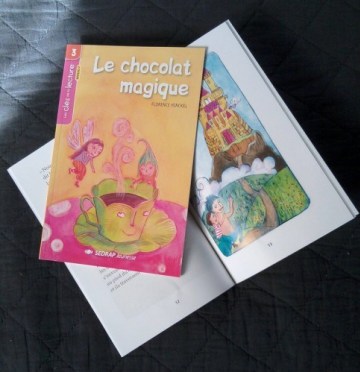25 février 2008
Le bonheur
On court après le bonheur avec de drôles d’images dans la tête : un gamin en noir et blanc qui boit son bol de lait sous l’oeil de Willy Ronis, des virées familiales en vélo, le ronronnement tranquille et rassurant du frrr frrr de la dynamo et du mécanisme pneumatique. Que tout tourne rond, que le moteur de vent mouline l’air de rien nos routes de mémoire (ça c’est une citation de je sais plus qui).
Le bonheur qui devrait être une large route vers l’avenir, se trouve être une expo de photos anciennes. Il devrait être de mille couleurs et il est en noir et blanc.

Le bonheur, c’est vrai, je l’ai éprouvé lorsque j’ai promené mon fils en vélo, lui sur le siège enfant à l’arrière. Je n’étais pas en sépia pourtant, et l’air printanier que je fendais sous le cri des oiseaux gonflait la voile de mon coeur. Mon fils sur le siège à l’arrière disait : chuis un garçon, moi, et contente, moi. Oui oui Ange, tu es un garçon contente, je t’aime mon bout de chou, même si ces temps-ci j’ai quelque pulsion meurtrière envers toi.
Je l’imagine fonçant roulant dans quelques années sur cette même route vers ses copains, heureux d’être là, de fendre l’air qu’a fendu sa mère, heureux d’avoir un corps qui bouge et pédale. Lui vivra le bonheur à mille pour cent au présent puissance un milliard. Moi, comment vivrai-je alors le bonheur ? A travers lui ou à travers le souvenir de moi que j’aurai à travers lui ? Car oui le vélo c’est l’enfance, celle de nos enfants et la nôtre, on a tous ressenti ce bonheur de rouler en trombes en se disant : c’est donc ça la liberté ! Je veux la connaître plus grande encore, ah ben oui c’est ça, je veux grandir pour en dévorer davantage.
Le bonheur adulte devrait être aussi simple que ces tours de vélo. Il l’est d’ailleurs, si l’on veut bien se détacher de ses nostalgies. Nous, on va repeindre notre vélo d’une couleur pimpante, de cette peinture qui brille et éblouit, on va l’enfourcher, régler les vitesses et rouler le plus vite possible vers le soleil, histoire de grandir encore, on n’en a jamais fini. C’est la roue de la vie.
La prochaine fois, je vous parlerai du bonheur enfantin de se prélasser après avoir nagé dans la mer à perdre haleine.
20 février 2008
Quelque baume au coeur
Une fois n’est pas coutume, un peu d’autopromotion, hein !
D’abord voici l’affiche de Livre, mon ami, le prix du livre jeunesse de Nouvelle-Calédonie pour lequel est préselectionnée ma Guerre des Vanilles (si vous cliquez sur l’image vous vous retrouverez sur le site idoine) :
Et ensuite, on me signale, sur le blog d’une visiblement grande lectrice, une très bonne critique de La fille qui dort. Merci, chère Lily, ça fait chaud au coeur !
C’est ici : http://lily-et-ses-livres.blogspot.com/search/label/Hinck…
18 février 2008
Maximonstre
Le jour s’effiloche en traînées poudreuses. On peut distinguer encore quelques plumes cramoisies, celles d’Icare issu de Dédale, plumes danseuses et lentes à atteindre le sol. Des grains de sable brillant se trouvent aussi en suspension, ceux tombés des sacs trop remplis du marchand de sable ambitieux. Il a voulu nous faire trop rêver. Mais la nuit tombe devant nos pupilles, nuit noire et effrayante entre les troncs serrés, derrière se cachent les monstres de l’enfance.
Avant la forêt, il faut traverser un long tunnel. Quelle enfance n’a pas connu ces tunnels-là ? Sombres bien sûr et malodorants, des bêtes y ont dormi, et quelle est cette ombre au loin ? On n’ose avancer et on le fait pourtant car à l’autre bout se trouvent les promesses, ou un ami, un frère peut-être, ou un arbre muni d’une balançoire fantastique qui mène jusqu’aux cieux. Un enfant ne recule jamais, de toute façon. Enfant, j’avance en tremblant mais j’avance, car je veux voir la forêt. Je veux en humer l’humidité et caresser l’écorce des monstres, éprouver l’haleine des arbres et les griffes des branches. Je veux y poser mes pieds nus, sur la langue étalée des feuilles accortes, sur les orteils des pattes mortes. Je suis la reine de ma vie et je souhaite être effrayée en mon royaume.
J’avance donc, et j’entends résonner mes pas, les gouttes pliquent-ploquent autour de moi et une brume dense s’élève du sol. Je suis seule en mon tunnel et c’est bien ainsi. L’enfance est une longue solitude que supporteraient peu d’adultes. L’enfance est un palais merveilleux mais aussi ce tunnel sombre.
L’enfance c’est la gorge serrée de trop de chagrins, sous la protection de l’immensité des bonheurs. L’enfance, ce sont ces peurs délicieuses lorsqu’on sort des tunnels sombres. Car à ce moment-là une forte brise gifle la joue et envoie aiguilles et brindilles dans les yeux. La lune nous adresse un sourire torve et les ténèbres ricanent entre les frondaisons. Mais l’enfant est fier, figurez-vous. Il redresse le buste et ne pleurera pas. Il affrontera les souffles fétides et les caresses griffues, il criera plus fort que les chouettes effraies, il tirera la langue aux vampires chauves et aux souris volantes. Il en a envie pourtant, de déverser ses sanglots retenus en plein coeur de sa poitrine, de hurler sa peur de voir ses désirs mangés, ses plaisirs volés, sa lumière éteinte et son amour étouffé. Mais la peur est une autre sorte de brasier, et il avance, l’enfant, porté par la flamme de son âme qui carbonise la réalité.
Ce n’est pas un conte de fée. Désolée de vous dire que l’enfant sera dévoré. Le serial monster s’en lèchera les griffes ensanglantées, ses pattes meurtrières, et aiguisera ses crocs sur les os. Il lustrera sa fourrure avec le calme de l’animal repu, le désintérêt de toutes choses autres que lui-même sous la lune triste de rater le spectacle : un nuage passe. La nuit est noire, noire, et on ne voit pas le petit cadavre. Qu’importe, le monstre, lui, est heureux, de son bonheur de bête.
Et puis il sent comme une flamme monter en lui, lui aussi. Il se fiche du sort du monde, ne montrera jamais de désappointement ni de tristesse, il est encore plus fier que l’enfant. Pour le prouver soudain, d’un rire tonitruant il éclate, chassant le nuage qui escamotait la lune. Elle le regarde en silence.
15 février 2008
Ah, écrire comme Gould jouait…
13 février 2008
Hyacinthe
On ne sait pas ce qui nous tuera.
Mais il est vrai que lorsque nous serons tués, nous ne pourrons plus rapporter d’histoires. Ni contempler la beauté. C’est à cela que pensait Hyacinthe, debout dans une allée déserte, bras croisés, en uniforme. Une fenêtre à sa droite, longue et fine, découpait un rayon de soleil, infime et vain, tombant en flaque sur le parquet. Une flaque très précise et délimitée. Elle ne touchait pas Hyacinthe, dans l’ombre. Hyacinthe ne recherchait pas la lumière. Pas forcément. En tout cas pas celle qui fut trop évidente, comme ce rectangle de soleil sur le sol. Infime et vain.
Hyacinthe préférait tourner son visage vers le tableau devant lui, celui qu’il avait choisi aujourd’hui. Il resterait là de longues heures, cherchant à traquer sa vérité, la signification qu’il voudrait bien lui assigner. Ou peut-être pas. L’important serait la vague d’émotions qui le submergerait peut-être. Il serait heureux d’être submergé. Ce serait fantastique d’évoluer au fin fond des abysses, dans ce monde qui mime le silence, vaste espace d’ondes noires et lentes, d’éclairs fugaces et inattendus issus du regard de monstres indécis. Hyacinthe appelait les abysses de ses voeux, il souhaitait parfois quitter ce monde abrutissant qu’il ne comprenait guère.
Si quelqu’un était là, dans cette allée déserte, il serait certainement saisi par l’immobilité de cet homme. Il ne pourrait s’empêcher de l’observer, comme nous le faisons, nous, entité qui raconte. Il serait étonné de ne pouvoir décider qui de l’homme ou du tableau se mire dans l’autre. Etonné de constater que, bien qu’immobile, cet être était mouvant. Les contours de sa silhouette, les traits de son visage, semblaient aussi flous que les regards brillants des monstres marins. On lui chercherait des ouïes, des nageoires sous les tissus, des filaments issus de son dos. On s’attendrait à ce qu’il plonge, soudain, dans la toile rendue liquide par son propre regard. Lui seul serait capable de rendre leur texture aux couleurs jetées en touches cubistes sur le tableau devant lui, qui le regarde comme nous le regardons, comme le regarderait quiconque serait là aussi.
C’était ainsi que l’interrogeait Dora Maar.
Dora Maar en pleurs, c’était le tableau qu’il avait choisi aujourd’hui. Chaque jour un tableau, c’était son artisticum vitae, sa raison de survivre depuis des mois, sa façon de plonger au fin fond des océans de la vie insensée, tout en restant à la surface. Il gardait l’ horizon en vaguelettes à la lisière de ses yeux, il y veillait malgré tout, il pouvait y advenir quelque danger, pour les quelques êtres qu’il aimait, juchés sur des rochers émergeant ça et là. Il fallait veiller pour ça, pour eux. Dora Maar en larmes semblait implorer : qui sont-ils, sur les rochers ? Regarde, Dora, regarde, là, c’est ma mère, elle se nomme Paula, elle est encore belle tu ne trouves pas ? Même folle, elle est belle, que veux-tu. Regarde, malgré son regard aussi indécis que les monstres marins, son sourire est magnifique, sous le violet de sa longue chevelure. Une vraie sirène. Oh, et puis là, c’est mon père, massif et sombre, il semble taillé dans le granit, tout le contraire de moi, on l’appelle Jo, c’est pour Joseph mais il n’aime pas, c’est trop biblique selon lui. Ne pleure pas, Dora, sa vie n’a pas été si triste que cela, il a beaucoup travaillé voilà tout, trop comme tous les hommes de cette époque-là. C’est leur regard sombre et lourd qui nous impose le temps de rêver au lieu de s’épuiser.
Regarde-le sautiller, celui-là, il plongerait s’il ne craignait les monstres. C’est Antoine, mon tout petit. A l’origine, ce n’est pas le mien, je l’ai fait mien voilà tout. C’était l’Antoine d’Angèle, Angèle qui a quitté nos abysses pour rejoindre les nuages, tu la vois ? Envoie-lui mes baisers, elle était belle et douce, mais elle n’est plus sur les rochers, je n’ai plus à veiller sur elle, c’est elle qui s’en charge désormais, elle qui souffle parfois sur les vaguelettes et déplie mon âme froissée. Mais c’est indiscernable, je souhaite parfois des tempêtes. Antoine ? Il a 9 ans, oui, il est aussi beau qu’elle, et émouvant, si émouvant, heureusement beaucoup moins mouvant que moi, puisque ce n’est pas vraiment le mien, d’Antoine.
Et là-bas, tout là-bas sur ce rocher lointain ? Tu as remarqué toi aussi son air perdu ? C’est qu’elle n’est pas là depuis longtemps. Elle se demande ce qu’elle fait sur ce rocher au milieu de rien, elle se demande pourquoi elle ne voit que l’horizon à la lisière de mes yeux, elle ne sait rien de toute façon, pour l’instant. Elle, tu vois, je l’ai rencontrée la semaine dernière. Elle ne sait pas encore qu’elle a pris place sur ce rocher. Elle ne sait pas encore que c’est aussi pour elle que tu pleures, Dora. Il va bien falloir que je lui dise d’une manière ou d’une autre. Il va falloir que je lui dise : j’ai donné quelques larmes de Dora à ton âme. Je sais juste son prénom, à cette jeune femme faussement frêle, quelqu’un l’a appelée dans l’atelier, l’autre fois. Il a dit Laurène, et elle a levé les yeux.
10 février 2008
Ne nous privons pas de beauté : écoutons aussi le frôlement du tissu
Plis
Le ciel est magnifique ce soir, nuages gris, noirs, mouvants, j’ai de la chance, je les vois de ma fenêtre, je les vois courir vers d’autres lieux, peut-être des lieux où vous êtes, vous. On ne verra pas les étoiles, on les imaginera, sous ce ciel moutonné.
Je pense à un personnage, ce serait une fille, pas de celles dont on parle dans les magazines, elles n’existent pas ces filles-là, on les fabrique, juste. Ce serait une fille comme nous, comme la Camille de Fred Vargas, de celles qu’on ne verra pas tricoter des doudous rigolos et les vendre sur blog, pas de celles qui font du achteting (ah bon on dit shopping ?), pas de celles qui portent des pantalons serrés en bas, quelle idée, pas de celles qui ne vivent que pour les hommes, j’en suis désolée, les hommes.
Cette fille-là, elle se dessine dans ma tête, peu à peu. Ce ne sera pas moi, ce sera un de ces personnages dérangé par l’écrivaine, je me ferai pourtant la plus petite possible, promis. Elle ne serait pas d’une beauté qui tue, elle aurait cette beauté à nous filles ordinaires, juste la lumière dans le regard. La démarche souple, elle ne porterait pas de talons à ses chaussures. Mais elle aurait des plis dans l’âme, des plis et des replis, un millier peut-être. Chaque pli se défroisserait légèrement sous les mouvements de l’âme, à la manière d’un accordéon, et cela lui ferait échapper un souffle entre ses lèvres, une musique à elle que n’entendrait que celui qui l’aime. Car elle serait aimée, Laurène, oui elle s’appellerait Laurène, elle serait aimée, mais par un être compliqué. On n’aime pas les êtres compliqués, se dirait Laurène. Sa quête, ce serait une vie simple, juste simple, qui coulerait de source. Elle ne saurait pas encore que les sources se tarissent ou finissent saumâtres. Elle feindrait d’ignorer que ce sont les flux et les reflux qui font la vie, les courants, les torrents et les grandes rivières.
Laurène ne voudrait pas voir cela. Laurène se réfugierait dans les belles phrases, repousserait celui qui l’aime tant, elle aurait peur de tant de pureté, tant de sincérité, elle trouverait ça anormal, anachronique, effrayant.
Son truc à elle, ce serait les vitres, les cadres et les miroirs. Son boulot à elle, ce serait de les couper sur mesure, de voir passer de magnifiques reproductions de tableaux, qu’elle serait chargée d’encadrer et vitrifier. Donner des limites à la beauté, instaurer une surface vitreuse entre elle et la beauté, voilà ce serait cela son travail. Parfois il faudrait couper un miroir, dans lequel elle se mirrait auparavant. Elle trancherait dans son reflet, sans le moindre regret. Peut-être qu’elle ne se verrait pas, au fond.
Le garçon qui l’aime, ce serait peut-être un gardien de musée, ou un forain qui possèderait un labyrinthe de miroirs, ou un photographe, ou encore un peintre. Il serait alors fameux, genre Picasso, il la contemplerait comme ça et se dirait elle croit que pour elle je ne suis rien, mais je sais bien que je compte, je vais l’en persuader, peu à peu, très doucement avec infiniment de douceur. Alors il irait courir sous la pluie pour oublier qu’elle croit que pour elle il n’est rien, il lirait des poètes sublimes et n’y trouverait aucun réconfort, tant pis tant mieux au fond c’est celui qui aime qui vit le plus intensément. Ce serait lui le plus heureux.
Elle, elle coupe la beauté.
Voilà, ce serait un peu ça, je crois, oui. Je réfléchis aussi à un jeune garçon d’une quinzaine d’années fou amoureux d’une fille et de peintures, le tout lié, il serait extrèmement fou et extrèmement amoureux comme on l’est à 15 ans, ce serait extrèmement beau.
Comme toujours, oui, c’est une quête de beauté, c’est une question d’apparences, au fond, sous un ciel gris et noir et moutonneux, où les étoiles sont cachées.
09 février 2008
Merci
06 février 2008
Notre espace
L’excellentissime maison d’édition des 400 coups a désormais son espace sur Myspace, et c’est ici :
http://www.myspace.com/les400coupsfrance
On peut y trouver toute l’actualité des 400 coups en France : les nouveautés, les titres à paraître, les dédicaces, les salons auxquels ils participent…
Moi, chez eux, j’ai publié La Fille qui dort, et j’espère d’autres projets en cours et à venir. C’est quand même très chouette d’être fière de la maison d’édition chez qui on est publié. Souvent, les sentiments sont mitigés, mais là, je trouve leurs choix, tous sans exception, vraiment très audacieux, pertinents, de qualité (sans parler de moi, hein, un peu d’humilité tout de même !)
10:35 Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
04 février 2008
La trottinette
Lorsque j’étais petite, enfin préado comme on dit aujourd’hui, je me souviens, je me disais qu’un jour je serais capable d’écrire un bouquin de 300 pages qui décrirait seulement une heure de ma vie. C’était l’époque où les parents n’étaient pas terrifiés à l’idée de laisser leurs gamins s’ennuyer, ne rien faire, rêver. Je n’étais inscrite à aucune activité et c’était très bien comme ça. Je pouvais passer des heures à simplement observer le dessin du papier peint ou bien les inégalités du plafond. Je me disais qu’un jour je pourrais noircir des pages pour décrire un seul bibelot, et toutes les pensées afférentes, peut-être même que de cette façon le bibelot penserait lui-même. Je raconterais dans ce bouquin qu’à un moment je me suis déplacée de mon lit à la fenêtre, et ce déplacement prendrait 50 pages, au bas mot. Je faisais exprès de ne pas me déplacer très lentement, pourtant. Mais je veillais à tout : à la sensation de la moquette sous mes pieds, au déplacement d’air infime sur mon visage, à mon champ visuel qui changeait, à la position de mes mains, de mes pieds, à mon équilibre gravitationnel, que sais-je encore. Et bien sûr à tout ce qui me traversait l’esprit à ce moment-là. Je me doutais bien que ça ne ferait pas un roman passionnant, mais pas inintéressant pourtant. Je me disais que c’était important, ce que je non-vivais à ce moment-là, de cette façon-là. Après tout, je vivais, comme ça. C’était aussi ça la vie, et peut-être surtout ça. A cet âge-là, on ne se demande pas si on perd du temps, on s’en fiche éperdument, on vit ce qu’on veut comme on veut.
De la fenêtre, je regardais des minots jouer au skate dans la pente entre deux immeubles. Nous on devait être quelque chose comme au onzième étage. Je me souviens quand on oubliait quelque chose on se postait en bas et on criait comme tous les autres : maaaamaaan, pour qu’elle nous jette la corde à sauter délaissée puis soudain désirée.
Pour l’heure j’observais les skaters, et j’aimais l’idée de leur mouvement et de mon immobilisme à moi. Je me disais que de les décrire eux, et tout ce qui était à l’extérieur, de mon point de vue à moi surélevée et statique, pfiou, ça ferait une série de 3 tomes. Ca s’appellerait les skaters, et ça parlerait de soleil, de jeux, de bitume, de chute, de contre-plongée, de pensées et de sensations de ces minots-là, oh passionnant d’imaginer ça.
Je me souviens bien de ce moment devant la fenêtre, de ce moment précis, parce que quelques jours plus tard, ma mère m’a offert une trottinette, toute rouge la trottinette, magnifique, c’était étonnant parce que c’était rare les cadeaux à cette époque, elle me l’a donnée en me disant : tu me fais trop de peine à rester enfermée comme ça en regardant dehors, il faut que tu sortes… Alors là je vous dis pas tout ce qui m’a traversé l’esprit, au moins 600 pages. Je vous résume : maman ne me comprend pas du tout, maman ne sait pas, ne peut pas savoir ce que j’ai dans la tête, ce que j’ai dans la tête est à moi toute seule – sauf si je l’écris – sauf si je le fais lire un jour – maman croit que je suis comme tous les autres enfants, elle croit que je suis triste quand je ne bouge pas, quand j’observe, elle ne sait pas combien je suis vivante quand je ne bouge pas, mais tiens je n’ai pas envie qu’elle le sache, j’ai envie que personne ne le sache, sauf si un jour je décide d’écrire et de faire lire, si je veux continuer à le cacher, il faut peut-être que je donne le change, que je fasse croire, que je me coule dans le moule, que je colle à l’image qu’elle se fait de moi, oui voilà je serai comme elle croit, et puis en plus comme ça elle sourira, elle sera contente, et j’aurai encore plus la paix qu’avant, et je pourrai rêver encore plus librement, oui voilà.
En plus j’avais été traumatisée par Poil de Carotte, y’avait un passage sur un tambour ou une trompette en cadeau, je sais plus, dans tous les cas, quelle que soit sa réaction face au cadeau il se recevait une torgnole le Poil de Carotte, je me suis toujours méfiée des cadeaux depuis. Alors j’ai dit merci maman, et je me suis précipitée dehors avec la trottinette. J’ai joué avec les skaters dans la pente, je me suis bien éclatée, je me suis égratigné les genoux, c’était bien. En plus maman était contente de son cadeau.
J’ai appris, ce jour-là, que pour pouvoir rêver-créer en paix, il fallait faire preuve d’une certaine malignité. Il fallait rassurer les autres, bouger, parce que ça terrifie les autres, l’immobilisme apparent. Et puis on se rend compte qu’en se forçant à ça, ça nous fait du bien, quand même. On s’amuse, on en a besoin, on se ressource, on rit, on rend les autres heureux. Ensuite, on peut rêver-créer.
Le tout, c’est de savoir trouver le bon équilibre.
Je me demande aujourd’hui si je serais capable d’écrire ce livre dont je rêvais enfant, où il ne se passerait pas grand-chose, juste des vagues de pensées et de sensations souterraines, pas ennuyeux pourtant, non, bien au contraire. Je me dis que peu à peu, je m’en approche. Peut-être bien, oui. Il me faut peut-être encore un peu de courage. Ou d’audace. Ou de temps. Ou de pensées enfantines.