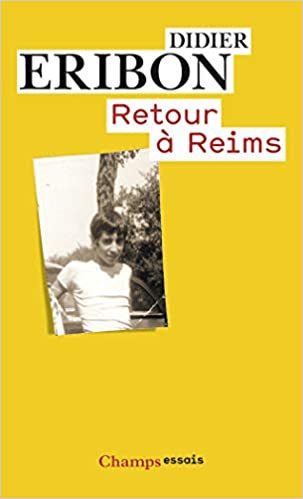Enfin le temps de dire en quelques mots mon ressenti sur le dernier Carrère (dont je laisse volontairement la photo floue, entre ombre et lumière, ça lui va bien à ce « Yoga » pas très zen).

Disons-le tout net, j’aime tout ce qu’écrit Emmanuel Carrère, et même son côté « je ne suis pas du même monde que la plèbe » ne me dérange pas (tant que ça) parce qu’il en a conscience, l’assume, et essaie d’atténuer ses réflexes de classe (il n’y a qu’en inclinaison amoureuse qu’il ne fait aucun effort pour briser ces barrières, ce qui serait stupide, et là encore il en a conscience et le dit, donc allez, on lui pardonne).
C’est bien son honnêteté et ses tentatives permanentes de déterritorialisation au sens deleuzien qui me passionnent, parce qu’il vit « une autre vie que la mienne », qui par conséquent forcément m’intéresse. Tout au long du récit, j’ai éprouvé infiniment de peine pour Carrère, qui se bat contre lui-même (voire contre 2 lui-même comme il l’explique très bien), et qui en souffre atrocement. Cette souffrance psychique est relatée dans un compte-rendu intime qui n’a rien de glauque, parce que Carrère a toujours l’intelligence de tenter de s’ouvrir au monde et aux autres pour sortir de l’enfer d’être soi. Il fait même cet effort que l’on devine monumental de partir loin de chez soi et de son confort pour y parvenir. Il a conscience du pathétique de sa souffrance face aux malheurs qui l’entourent (attentats, migrants…), et du pathétique de ses efforts pour en sortir, face aux gens qui souffrent « pour de vraies raisons », ces gens dont il recherche la proximité pour relativiser la sienne, de souffrance. Ces efforts très louables et cette agitation sont passionnants (je trouve). S’il n’est d’après moi arrivé que peu à rendre chair aux « garçons » de Lesbos, trop abîmé dans la sienne, de chair, il nous offre un personnage haut en couleurs et très attachant avec Erika – sans doute parce que ce personnage fait davantage partie de la psyché de son auteur, incapable de s’en détacher (et c’est bien son problème).
Plus que dans ses autres récits d’autofiction, j’ai pu être agacée par le simple fait que Carrère soit un être plutôt mieux né que la moyenne, et qui a donc plus de chances dès le départ d’être écouté quand il parle de lui, mais ce récit plus que tous les autres m’a forcée à lutter contre ce sentiment d’agacement qui ne me grandit pas, parce que eh bien, pourquoi s’empêcherait-il de ne pas parler de lui et de ses souffrances ? Elles sont à prendre en compte autant que d’autres, et notre empathie ne doit pas s’arrêter aux portes des entre-soi. C’est un peu ce qu’il nous enseigne au final, dans un sens certes plutôt plus facile pour lui que pour les ouvriers, ouvrières, ou les chômeurs et chômeuses qui galèrent (par ex) qui le liraient, mais c’est un enseignement que je prends volontiers, personnellement, en ces temps de crise où les crispations se resserrent et les barrières s’agrandissent entre gens de « mondes » différents, ce qui m’attriste.
Tout de même, j’attaque, après la lecture de « Yoga », « Retour à Reims » de Didier Eribon, pour faire bonne mesure, parce que j’ai quand même un peu besoin d’air sociologique.