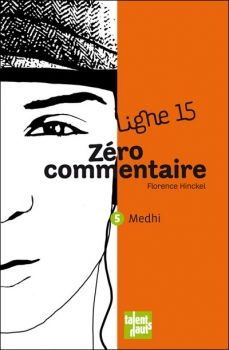La torpeur baby-bluesesque qui suit la fin de l’écriture de La Ligne 15 : j’ai choisi au début de l’assumer complètement, d’en profiter pour lire, lire, lire, regarder quelques bons films, profiter du printemps, la douceur des soirées longues, les amis que l’on voit plus souvent, les enfants qui dorent au soleil en riant… Mais au bout de quinze jours qui parurent quinze ans j’ai réalisé que je ne faisais que me voir vieillir en vivant ainsi, en profitant de la vie simplement ! Dans l’affolement naissant je me suis tournée davantage vers le monde : grands dieux, pitié pour le monde. J’ai esquissé des projets pour m’y jeter davantage : redevenir enseignante ? Je caresse souvent cette idée, car j’aime ce métier, j’aime les enfants, j’aime les ados, j’adore leur énergie, et j’aime transmettre. Mais lorsque je discute avec mes amies instits, épuisées, impuissantes, pleines de bonne volonté écrasée, l’idée me quitte rapidement. Ne serais-je pas plus utile ailleurs, autrement, et en souffrant moins ? (Je ne parle que pour moi, je sais que certains enseignants que je juge super-héroïques se donnent dans leur métier avec une telle foi qu’ils n’en souffrent pas, malgré la très évidente volonté gouvernementale de leur compliquer la vie. Total respect).
C’est à ce moment-là que quelque chose enfle et monte, quelque chose de conséquent à tous ces états-là, accompagné d’une forme de soulagement. Enfin la vie a un sens, ou bien je vais lui en donner un. C’est cela qui monte, le désir de sens et de projection dans le monde, de la façon la plus personnelle qui soit, la plus libre possible, donc la plus heureuse. Les choses montent, il reste à les laisser émerger, y faire le tri, les transformer. Ecrire. Ouf.