Ai tourné hier soir la dernière page de ce monument de la littérature russe.
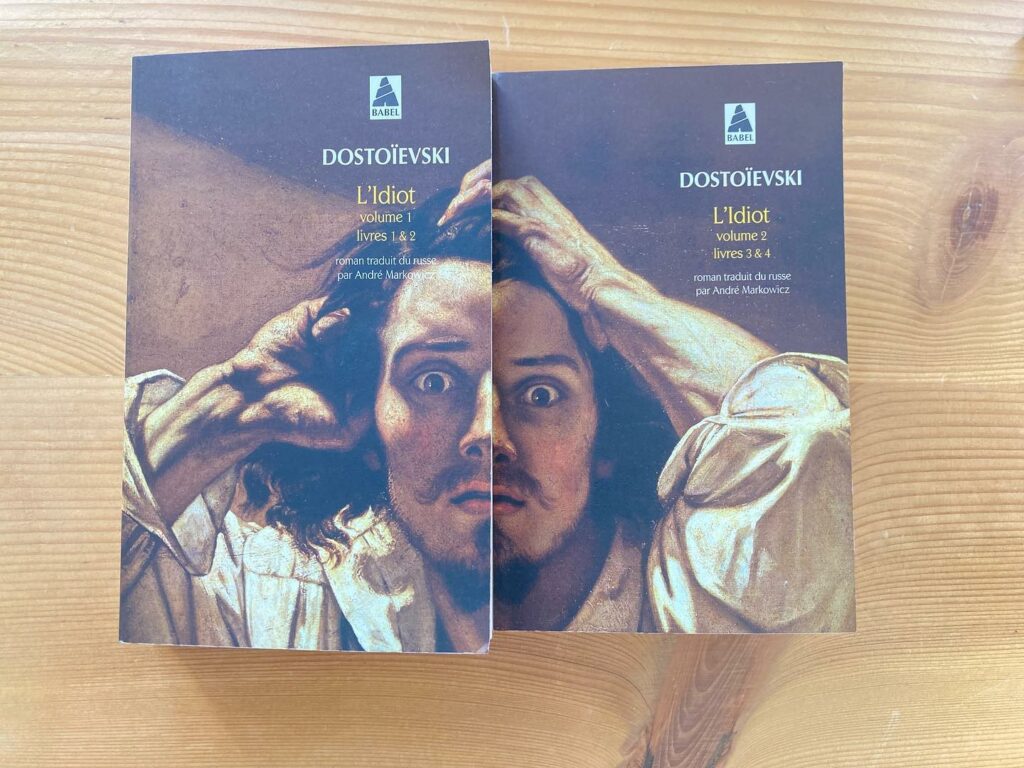
Pour ensuite rêver toute la nuit de couteaux luisants dans le noir, de discours enfiévrés dans des salons de gens bien mis, de mourants tourmentés, de malades mystiques, d’amoureuses fières et hésitantes, de rêves effrayants, de vociférations et et de dialogues échevelés. L’idée de départ est géniale : plonger dans notre monde cruel un être d’une bonté christique, qui ne connaît ni envie ni jalousie, et capable d’empathie entière et complète envers tout un chacun, même s’il lui veut du mal.
On découvre que personne n’est prêt à croiser un tel être, tout le monde est inapte à le côtoyer, même en l’aimant, même en l’admirant, et si toute la société en vacille sur ses bases dysfonctionnelles, cela ne débouche jamais sur quoi que ce soit de fonctionnel.
Tout au long de ma lecture je m’exclamais tout haut : mais comment peut-on écrire de telles choses ? De tels dialogues complètement dingues ? Et, mais, a-t-on le droit de faire ça ? Le narrateur parfois nous explique que lui-même ne sait pas trop comment raconter ce qui s’est passé, ou n’en sait pas assez (eh oh, Fiodor, c’est toi qui as inventé l’histoire ! Mais qu’importe, c’est un délice ce que tu nous fais croire).
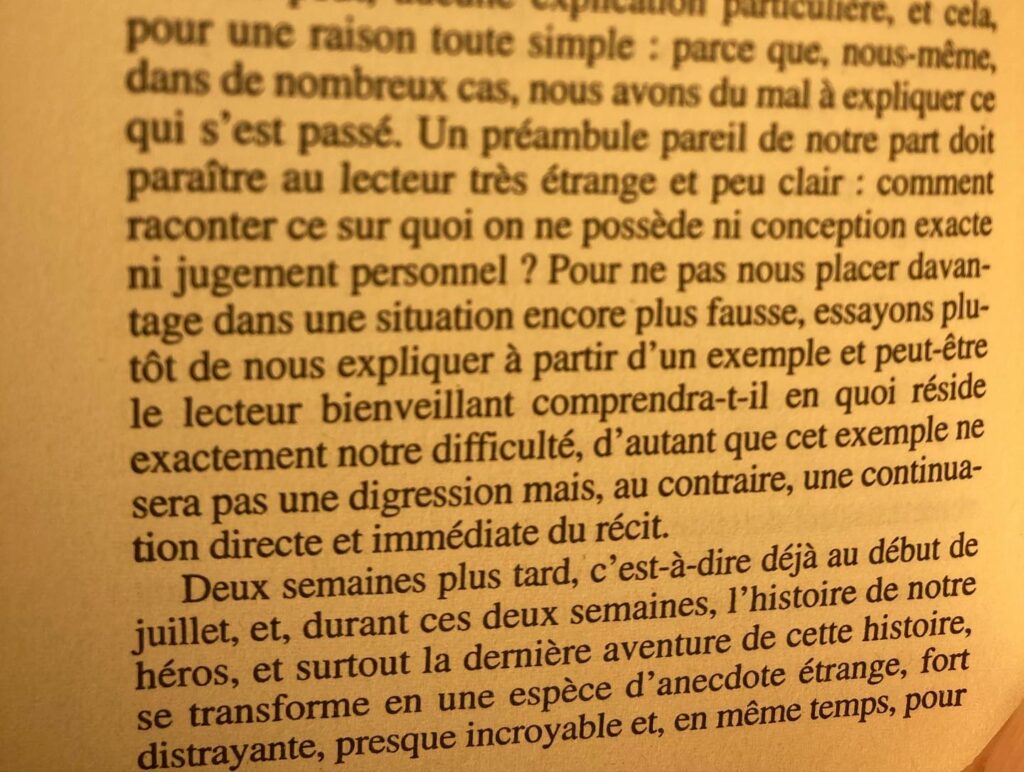
Ou bien un personnage explique qu’il va lire une lettre pendant une heure, même s’il sait qu’elle est pleine de passages inutiles. Et hop, sans coupe, voilà l’intégralité de la lettre. On est sidérée, et on adore être sidérée.
Bref, une expérience inoubliable que la lecture de L’Idiot, différente de celle que j’avais éprouvée en lisant Crime et châtiment ou Les frères Karamazov (adorés tous les 2). On sort de cette lecture dans un état d’hébétude heureuse, comme sortie d’un rêve tumultueux et passionné.
Oh, bien sûr, la traduction est de André Markowitz.








