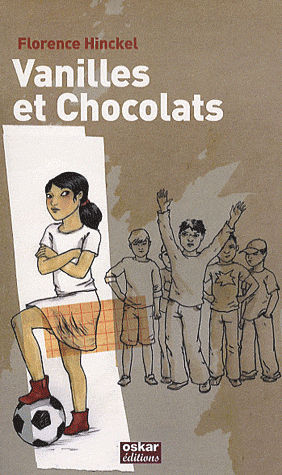Ca faisait longtemps que je n’avais pas vécu le dilemme du mauvais texte (sans forfanterie). Je ne sais pas ce qui m’a pris, ou bien ce qui m’a pris c’est la tristesse de voir un texte orphelin. Il était déjà mauvais, quelques années auparavant. Mais je me suis dit, allez, y’a qu’à en couper la moitié, remanier tout ça, et ça pourrait donner quelque chose de pas mal ! Et hop je me lance dans le jeu de massacre, mue par je ne sais quelle énergie et encore moins quelle motivation, d’autant que j’ai deux projets enthousiasmants à venir, auxquels je réfléchis depuis un petit moment. Mais peut-être justement qu’il s’agit de la peur de s’y lancer. Le pire c’est qu’après un peu de temps à retravailler un mauvais texte, on est toute disposée à le trouver vraiment pas mal ce texte-là. Mais oui, en fait, pas mal du tout. C’est fou comme le nez sur le guidon on peut en oublier tout le cheminement fait durant plusieurs années et tout un questionnement sur : qu’est-ce que je veux proposer aux enfants ? Mais j’y crois à ce moment-là, voyez-vous. Bon, je suis quand même consciente que ça n’a pas l’étoffe d’un roman, mais pourquoi pas celle d’un bon texte pour magazine de presse ? Je le propose donc. Et figurez-vous une chose : je réalise que je suis soulagée lorsque la dame, très poliment, me le refuse dès le lendemain. J’ai soudain tout à la fois une grande honte d’avoir osé proposer un truc pareil (certes pas mal écrit, pas mal mené, mais hyper moralisateur et pas fin pour deux sous – grands dieux pauv’zenfants), et une jolie foi dans la qualité du monde éditorial jeunesse. Mes textes acceptés sont donc réellement bons ? Alleluiah.
Et que je me le dise : un mauvais texte restera toujours un mauvais texte. Et enfin : enterrons les daubes du passé.
Il y a des deuils joyeux.